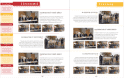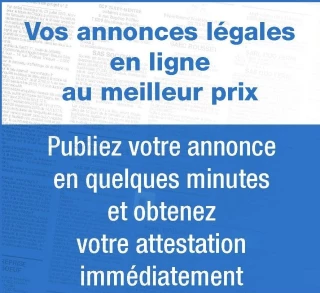Projets hydrogéologiques : réalimentation et réutilisation... qu'est-il possible de faire ?
Alexandre Duzan, hydrogéologue de formation et expert ressources en eau chez Suez, nous a parlé, le 20 avril, de ce qui existe déjà, en matière de réalimentation de nappes ainsi que de REUT (Réutilisation des eaux usées traitées). Deux types de projets encore rares sur le territoire métropolitain. Les verrous ne sont pourtant ni technologiques, ni réglementaires. Ils sont plutôt politiques et idéologiques.

En France, les deux tiers de l’eau potable qui alimente les consommateurs proviennent des eaux souterraines. Le tiers restant est issu des eaux de surface. Ces réservoirs forment, à eux deux, ce que l’on appelle les "eaux conventionnelles". Au vu des bouleversements climatiques actuels et de la baisse accrue de la disponibilité de la ressource en eau, deux options apparaissent. D’une part, le stockage des eaux de surface (à moindre impact sur les milieux) et d’autre part, l’utilisation des eaux non conventionnelles. Tout cela dans une dynamique de préservation de la ressource.
Le stockage de l’eau pluviale qui tombe en excès, en hiver, est pratiqué depuis des siècles. « Récupérer les eaux de surface, en respectant les débits minimums biologiques […] tout cela est compatible », introduit Alexandre. Il faut surtout bien connaître « la réalité du projet dans l’impact net », explique-t-il. Cela permet une meilleure vulgarisation auprès des acteurs d’un territoire. En passant aussi par l’enquête publique et l’instruction des dossiers auprès des services de l’État.
La Saône-et-Loire est loin d’être le territoire le plus en tension autour de l’eau. Néanmoins, il s’agit d’une zone ayant toujours connu l’abondance et aujourd’hui, les situations de stress hydrique deviennent de plus en plus fréquentes. Se déshabituer à cette abondance et faire face à de nouvelles contraintes peut être, ainsi, encore plus difficile. Sur tout l’axe de la Saône, les sols sont alluvionnaires. Grâce aux hautes eaux, les nappes souterraines se rechargent vite. À condition qu’il pleuve assez l’hiver ; ce qui n’a pas été le cas cette année. Le territoire a connu une sécheresse hivernale sans précédent. Cet été, les basses eaux des rivières seront, par conséquent, à leur tour, peu réalimentées par la ressource souterraine.
La réalimentation des nappes est déjà pratiquée
La réalimentation des nappes, aussi appelée "recharge maîtrisée des aquifères" par le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), consiste à introduire volontairement et de manière maîtrisée, de l’eau dans une nappe phréatique, afin d’augmenter sa recharge naturelle. « On observe la nature et on propose des industrialisations de sites, en respectant le cycle de l’eau et les milieux naturels », développe Alexandre. Une fois réinjectée dans la nappe, l’eau se déplace très lentement. Plusieurs types de dispositifs sont possibles, suivant les caractéristiques hydrogéologiques du terrain et l’ampleur du projet. L’usage final de la ressource réalimentée conditionne les besoins éventuels en pré et post-traitements. Légalement, en France, la recharge via des eaux de surface est autorisée. Par contre, la réinjection d’eaux usées traitées ne l’est pas. Même si les récentes annonces gouvernementales (Plan eau) laissent envisager de nouvelles perspectives dans le domaine. Qu’est-ce qui différencie recharge directe et indirecte ? C’est simple. Dans le premier cas, l’eau est directement réinjectée dans l’aquifère via un forage. Tandis que la recharge indirecte requiert l’installation de surfaces d’infiltration (bassin, puits, galerie drainante…), permettant à l’eau de percoler jusqu’à l’aquifère libre.
Au niveau de la temporalité, la durée pour réaliser un tel projet est, d’au minimum, deux ans. Une étude de faisabilité est d’ailleurs en cours, sur le secteur de la Métropole de Dijon. La réalimentation de nappes, technique encore peu répandue en France, est aussi utilisée dans les villes côtières, pour éviter les intrusions d’eau de mer au sein de la nappe d’eau douce. Sans cette recharge, l’eau saumâtre, chargée de sel, remonterait dans les captages d’eau potable.
Réutilisation des eaux usées : « il faut repenser les dispositifs »
Les EUT (Eaux usées traitées) sont très peu réutilisées en France (moins de 1 %), contrairement à d’autres états. Pourtant, elles offrent de nombreuses perspectives d’usage : irrigation agricole, arrosage d’espaces verts, industrie… Le cadre réglementaire de l’irrigation est fixé par l’Europe. Ce dernier définit différentes "classes". La classe A correspond à la meilleure qualité obtenue, D la dernière. Avec une eau traitée de classe B, par exemple, toutes les méthodes d’irrigation sont autorisées pour les cultures vivrières consommées crues, sans que la partie comestible n’entre en contact direct avec l’eau. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’aujourd’hui, « on a tous les outils technologiques pour traiter n’importe quelle eau », souligne Alexandre. « D’un point de vue technologique, les eaux usées peuvent être utilisées, après c’est un choix politique », poursuit-il.
Au sein d’une station de traitement, les procédés de filtration se succèdent, devenant de plus en plus précis. Pour produire une eau de qualité, une étape "tertiaire" est indispensable (via un filtre à sable ou des technologies plus poussées comme l’ultrafiltration), quel que soit le projet de REUT. Or, en France, seules des STEU (Stations de traitement des eaux usées) situées dans des collectivités littorales l’ont déjà mise en place. En général pour améliorer la qualité des eaux de baignade. À la suite de ce traitement tertiaire, une étape de désinfection (chlore et/ou UV) doit forcément être ajoutée. Elle n’est, pour le moment, installée dans aucune station. En termes de délai, il faut au moins compter 18 à 24 mois pour un projet de REUT nécessitant l’installation d’un traitement complémentaire, ou la conception d’une nouvelle STEU. En Australie, à Adélaïde, les eaux usées traitées sont réutilisées pour irriguer toute l’aire horticole du Nord de la ville. Exemple plus local : Clermont-Ferrand, où 750 ha de maraîchage sont directement irrigués par des eaux sortant d’une station d’épuration.
Les irrigants sont actuellement dans le viseur des politiques publiques ; leurs activités engendrant des prélèvements importants. D’où la nécessité de réfléchir sur le long terme, pour ne pas davantage cristalliser les tensions sociétales autour de l’eau et de l’agriculture. De prime abord coûteux, ces dispositifs s’amortissent réellement, d’autant plus au regard des prévisions climatiques. Pour qu’un projet naisse, porté par exemple par un groupe d’agriculteurs, il faut bien sûr qu’en amont, une étude d’opportunité ait été menée.
« C’est toujours la contrainte qui est motrice », déclare Alexandre. Des pays n’ont, depuis des années, d’autre choix que de dessaler l’eau de mer. D’ailleurs, en cinquante ans, l’énergie requise pour dessaler un mètre cube d’eau de mer est passée de 10 kWh à 3. Cela rend le processus de plus en plus attractif. On discute ici seulement des progrès technologiques, et non pas des potentiels impacts biologiques de certaines pratiques peu encadrées.
Finalement, « les approches sont extrêmement réductrices », regrette Alexandre. Même si la réglementation tend à évoluer, « en France, on commence à peine les discussions sur la thématique des eaux usées traitées réinjectées », souligne-t-il.