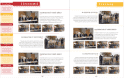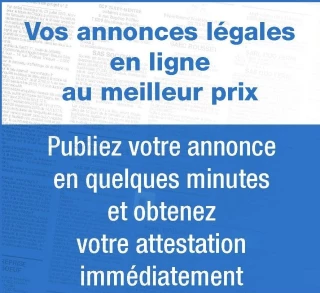Des industriels bien différents demandent d'élargir EGAlim
Le 28 février, dans le cadre du suivi de la crise agricole, des acteurs de l’industrie agroalimentaire étaient invités à témoigner à la préfecture de Mâcon. Si les centrales d'achat de la grande distribution semblent faire "peur" à tous, les acteurs industriels demandent que les lois EGAlim soient prolongées à tous les industriels, grossistes, RHF et même à l'État, lui-même pour ses normes qui induisent aussi des "coûts de production" normatifs.

Difficile de dire qu’ils se ressemblent hormis le fait d’être classés dans le secteur de la première transformation agroalimentaire : Moulin Nicot, Foulon-Sopagly, LDC, Régilait, Clavière Viandes, Palmid'Or, fromagerie Chevenet… Reste qu’ils sont actuellement sous l’œil attentif des agriculteurs, qui poursuivent leurs mobilisations, et des services de l’État qui étaient encore mercredi 28 février au soir tous présents à Mâcon (DDT, DDPP, DDETS, DDFip, sous-préfets…). Avant de donner la parole aux industriels, le préfet Yves Séguy leur demandait de témoigner sur leurs « démarches de contractualisation avec les agriculteurs et leurs difficultés à développer ces partenariats », histoire de ne pas tourner autour du pot. « Quid de la rémunération qui retourne aux producteurs ? », rajoutait Jean-Pierre Goron, le DDT. Et par une étrange circonstance, le tour de table donnait à voir toute la diversité des situations allant des marchés « totalement intégrés » aux plus « libéralisés » (lire encadré).
« Miracle » pseudo-français
Chez LDC, le géant français de la volaille, même « s’il découvre les principes » de la contractualisation du type EGAlim (option 2), le volailler a de longue date mis en place un « contrat trois points », reprenant les indices publics mensuels Itavi « pour adapter avec régularité le prix en fonction des variations sur 3 mois, afin de neutraliser la volatilité » des cours de l’alimentation animale notamment, comprenait-on. Charge à LDC ensuite de les « répercuter » à ses clients. 90 % des éleveurs seraient ainsi en contrat « d’intégration » avec LDC. Pour le vice-président de JA71, Julien Quelin, « l’intégration roule » de la mise en place des volailles jusqu’à leur ramassage.
« Pas sûr que cela marche en viande bovine », remarquait-il néanmoins. Pour autant, le représentant de LDC pointait le « miracle de l’origine », ironiquement, avec des poulets brésiliens arrivant à Rotterdam et qui soudainement devenait Français ou Européen chez d’autres concurrents ou restaurateurs, osant même afficher une origine UE sur leurs plats préparés. Les services de la Répression des fraudes (DGCCRF) semblaient découvrir cette pratique et le préfet promettait de faire remonter pour enquête. JA71 dénonçait cette tromperie pour les consommateurs et cette concurrence déloyale (des conditions d’élevage, dumping…) pour les éleveurs. Car Julien Quelin sait que les « Français veulent manger pas cher, plutôt que cher », ce qu’avaient bien expliqué les acteurs des grandes surfaces alimentaires deux semaines plus tôt. LDC affirmait en revanche avoir « respecté les délais fixés par l’État pour négocier avec les GMS et plutôt fait admettre (aux GMS) la hausse des matières premières agricoles » (MPA). Le directeur de Palmid’Or, Christophe Morel réclamait aux services des Fraudes d’enquêter sur « les poulets Ukrainiens, qui déjà avant la guerre, venaient être transformés en Belgique pour revenir Français » dans nos supermarchés. Des fraudes à l’origine qui semblent massives, alors que déjà plus d’un poulet sur deux consommés en France n’est plus Français.
Gare à l'effet ciseau de cours
Pour la filière fromages, le chevrier/fromager, Thierry Chevenet expliquait sa collecte chez 25 producteurs fermiers. « Avec intégration de certains élevages, je connais les prix MPA ». Devant le préfet, il introduisait des « séparations » entre les marchés du lait AOP « tracé » et les marchés des laits plus conventionnels. Lui qui produit notamment des fromages AOP, voit bien la différence entre « du haut de gamme que le client accepte de payer » et « la grande consommation avec des vrais prix psychologiques », notamment le seuil des 1 € le litre de lait en brique au client.
Paradoxalement, il ne semble pas rencontrer de difficulté à négocier des « contrats tripartites » avec des indices (Ipampa) avec les distributeurs, même si cela reste plus « complexe administrativement ». Son souci est plus sur la temporalité des hausses et des baisses, malgré « une fourchette de prix négociés » et une renégociation si nécessaire. « Il y a un décalage entre le moment où l’indice baisse et le moment où les coûts baissent chez l’éleveur. Il ne faut pas que le distributeur baisse alors que l’éleveur a acheté à prix fort » car l’éleveur peut « arrêter très rapidement » de produire sinon. Et l'effet ciseau est actuellement à son paroxysme après les hausses des cours avec la guerre en Ukraine qui reviennent brutalement en dessous des coûts de revients. Lui, en tant que collecteur-transformateur, affirme marger « entre 18 % et 55 % selon le produit », donc n’ayant pas la même flexibilité partout pour encaisser la perte de marges durant les négociations.
Sur le marché des laits en poudre cette fois, le représentant de Régilait expliquait ne pas collecter le lait directement mais presque puisqu’étant une filiale de deux coopératives, Sodiaal et Laita. « Nos éleveurs ont la clé du directoire et conseils de surveillance. Ce sont eux qui décident de l’objectif de valorisation du lait. C’est un système vertueux sauf quand il y a un caillou dans la chaussure ». Et ce « caillou » est souvent la centrale d’achat des grandes enseignes de distribution. « La contractualisation et l’objectif de valorisation se heurtent à cette réalité », se contentait-il de dire, sachant la réunion en présence des médias.
Des éleveurs pressés d'attendre
Le directeur de Clavière Viandes, Didier Rativeau se montrait plus explicite : « on est en concurrence. On n’est pas assez puissant pour s’imposer. On est obligé de passer sous les fourches caudines des grandes surfaces qui pourtant connaissent nos hausses », ne citant aucun nom. « Je veux garder des clients ». Avec une centaine de gros bovins par semaine, Didier Rativeau fait ses achats auprès des groupements de producteurs et directement dans les fermes. Il rappelait que la contractualisation EGAlim « doit être proposée par le vendeur. Depuis deux ans, les cours augmentaient et les éleveurs étaient pressés d’attendre », remarquait-il. Pas faux, regrettait Julien Quelin qui pousse au JA71 pour développer la contractualisation.
Didier Rativeau expliquait à demi-mot sa situation, comme celle de ces confrères, « petits industriels si l’on compare aux 2.000 bêtes par semaine chez Bigard », notait gentiment Julien Quelin qui signalait ainsi l'absence de l'industriel. Didier Rativeau se reconnaissait bien dans la définition du préfet de faire un métier de « centimiers » : « On a quelques débouchés où l’on trouve de la valorisation mais néanmoins on a besoin de volume et là, on arrive à une impasse avec la décapitalisation. On fait de gros chiffres d’affaires avec des résultats de misère. On gagne, on perd, sans se plaindre. Je prends 1,5 centimes par kilo de viande », lui qui fait abattre à Besançon, Autun, Lons, Pontarlier principalement des bovins du bassin Charolais. Il constate néanmoins une grosse différence avec son activité de porcs. « Avec les éleveurs de porc, on négociait à l’oral. Avec EGAlim, on va tous devoir embaucher des secrétaires. Mais les salaisonniers acceptent la fixation de prix ou de se revoir » en fonction des coûts de production sur des porcs Label Rouge ou Bleu blanc cœur. Le secrétaire général de la FDSEA, Anton Andermatt posait donc la question du Bio ?
Le haut de gamme décroche
« On n’a pas de demande ». Pire en lait, Thierry Chevenet rajoutait que le « lait bio est dégagé bien moins cher que du conventionnel ». En viande aussi, la réalité des marchés est que « 60 % de la viande bovine est transformée en haché standardisé », pas forcément des steaks mais aussi dans des plats préparés. « Il n’y a plus que 40 % d’un bovin qui peut être valorisé », concluait Didier Rativeau, voire pire en porc « avec 25 % pour les jambons ».
Julien Quelin a peur donc que si rien n’est fait, « soit les petits industriels vont s’arrêter, soit les producteurs seront la variable d’ajustement ». Le vice-président, Mansour Zoberi, ancien dirigeant du groupe Casino appelait à « faire des rapprochements entre acteurs de proximité, pour que nos territoires ne se désertifient pas », sachant le rôle crucial des petits commerces, notamment dans les campagnes. Un appel qui est d’autant plus sincère à l’heure où l’enseigne Casino « tombe », racheté par Intermarché et Auchan, rendant encore plus puissants ces multinationales aux filiales horizontales et verticales (producteurs, transformateurs, MDD…).
De multiples intermédiaires et coûts réglementaires
« Il y a deux mondes », débutait le directeur chez Foulon-Sopagly, Richard Payraud. L’industriel à Mâcon produit chaque année 30 millions de litres de jus de raisin par exemple à destination de l’industrie. Mais pas que. « Il y a le marché dédié et l’écart de tri ». Sur ces premiers marchés « dédiés, captifs » (cassis de Bourgogne, pomme cidricole…), « on contractualise quasi à 100 % », se félicite-t-il. En effet, avec son client industriel, tout est prévu d’emblée, « de la plantation à la production jusqu’à l’embouteillage et le distributeur, on se met d’accord sur des contrats pluriannuels ». Une filière "intégrée" donc en quelque sorte. En revanche, en « écart de tri » des fruits, « c’est à la criée tous les matins, jour après jour, personne ne veut s’engager sur du pluriannuel », explique Richard Payraud. L’incertitude règne donc en maître dans ces marchés à forte concurrence. « Notre métier est de savoir se couvrir et qu’aucun maillon ne casse ». Comment ? En essayant de faire en sorte que tout le monde « s’engage », à commencer par le distributeur pour remonter la filière jusqu’aux producteurs. « C’est souvent une volonté des coopératives ou de regroupement de producteurs que nous accompagnons ». Il donnait l’exemple des jus de pomme pour la marque « C qui le patron ! », qui s’appuiera bientôt sur 600 ha de pommes dans « un schéma 100 % dédié ». « Les producteurs sont alors en contrat glissant avec leurs coûts de production et indexé correctement ». Mais sur d’autres marchés de jus de pomme, non « captif », en raison de la pénurie de pommes en France, l’entreprise Foulon-Sopagly va s’approvisionner en Europe et pays tiers, hors Europe, reconnaît Richard Payraud qui répond aux demandes de ces clients industriels et distributeurs. « On passe 80.000 t de fruits par an. Quand la conjoncture est favorable, on n’importe pas une pomme mais sinon, il faut savoir que la Turquie ou la Pologne produisent trois fois plus de pommes que la France », qu’il peut être amené à transformer en jus.
Un discours franc, qui ne fait pas forcément plaisir, mais qui est également la réalité des moulins Nicot à Chagny. Son directeur, Jean-Philippe Nicot ne connaît qu’un « driver », celui de l’offre et la demande sur les marchés internationaux, comme le reste de la filière céréalière. « La France, la Bourgogne-Franche-Comté et la Saône-et-Loire sont exportatrices de blés », remarque-t-il lui qui travaille avec les coopératives et les « quelques » stockeurs privés. Dans ces marchés en « hyperconcurrences », la contractualisation est « extrêmement rare », alors qu’il avait - avec les coopératives « bienveillantes » régionales - été à l’origine du label Agri-éthique reposant sur ce principe de commerce équitable. La volatilité des marchés s’est même amplifiée depuis la guerre en Ukraine, avec des « Russes allant sur les marchés français du Maghreb ou Chinois ». L’inflation en Europe a provoqué la baisse du pouvoir d’achat et les « industriels se sont assis sur les blés bios », lui dont les farines pour les artisans-boulangers ne pèsent que 35 % des volumes. « Personne ne se rend compte de notre consommation hypertransformée » qui va avec nos modes de vies modernes. Pour Jean-Philippe Nicot, la contractualisation ne doit pas s’arrêter au premier acheteur de matière première et éventuellement à la fin à la grande distribution, « il y a très peu de demande de mes clients industriels ou de la restauration hors foyer », regrattait-il, qui donc représente à Chagny, 65 % de ses volumes. Et de tacler au passage l’État, demandant au Préfet d’intégrer dans les lois ÉGAlim tous ces intermédiaires de la filière mais aussi de rajouter les « coûts » de la baisse des phytos sur la productivité, les plans de décarbonation…
De grosses entreprises au milieu
Juste avant le Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté est la région est avant-dernière en France (à l’exception de la Corse) avec 27.820 emplois dans les industries agroalimentaires. Loin donc des 75.000 emplois dans la région Bretagne ou 70.000 en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour sa part, la Saône-et-Loire comptait 507 établissements (soit 21 % du total) fin 2022 générant 6.865 emplois. Dans le top 15 et même top 5 des plus gros établissements, on retrouve pourtant LDC à Branges, Bigard à Cuiseaux et Daunat à Sevrey (près de Chalon s/Saône). Avec un chiffre d’affaires total estimé à 331 millions d’€ par an pour l’agroalimentaire, le secteur des boissons pèse 47 % (192 M€) grâce notamment aux vins, avant les viandes (70 M€ ; 20 %) presque à égalité avec les autres produits alimentaires (68 M€ ; 20 %) et devant le lait (10 %). Mais ce sont bien la viande et produits à base de viande qui sont premiers en Saône-et-Loire en termes de parts de l’emploi agroalimentaire, devant la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires.