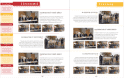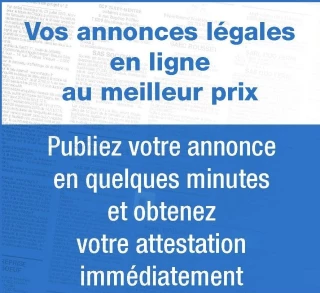Comprendre la réforme
Lancée en juin 2019, la réforme de la gestion des risques climatiques est sur le point d’aboutir. De nombreuses modalités opérationnelles sont encore travaillées en coulisses, et des ajustements sont à prévoir à moyen et long terme. Mais les grands paramètres sont connus, et le cahier des charges de l’assurance récolte pour 2023 ne va pas tarder à sortir. Le futur dispositif efface le régime des calamités agricoles jugé concurrentiel, pour donner place à un nouveau type d’intervention publique-privée. Dans ce schéma, les risques assurables sont confiés aux assureurs et les risques non-assurables à l’État, sans distinction de production (cultures de vente et prairies). Le but est d’inciter fortement les agriculteurs à s’assurer...

« Il faut sonner la mobilisation générale, appeler chaque agriculteur à se rapprocher de son assureur, de son conseiller de chambre, de coopérative afin d’étudier le nouveau dispositif et analyser, si oui ou non, il lui faut souscrire une assurance afin de préserver l’équilibre économique de son exploitation », martèle Pascal Viné, directeur des relations institutionnelles du groupe Groupama.
Après trois ans de gestation, la réforme de la gestion des risques climatiques en agriculture est dans la dernière ligne droite. Les derniers grands paramètres ont été annoncés en septembre, mais de nombreuses modalités techniques restent à affiner en coulisses, par les assureurs et par l’État, pour que le nouveau dispositif entre en marche, de façon fluide et articulée, dès le 1er janvier 2023.
Tout a commencé en juin 2019 quand, lors d’une « consultation élargie » lancée par le ministre de l’Agriculture de l’époque Didier Guillaume, les parties prenantes constatent que beaucoup d’exploitants sont insuffisamment protégés des aléas climatiques malgré la palette d’outils existants : méthodes de prévention, équipements de protection, épargne de précaution (DEP), assurances mono-risque, assurance récolte multirisque climatique (MRC).
Le problème : la concurrence des calam’
Ce dernier produit assurantiel, la MRC, retient l’attention car il présente plusieurs avantages. La MRC est subventionnée, elle est donc accessible à moindre coût pour l’agriculteur. Elle couvre de nombreux aléas climatiques : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d’eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon et vent de sable. Elle est aussi adaptable aux besoins de l’exploitant via le rachat de franchises et de garanties.
Créée en 2005, la MRC a subi un lifting en 2016 pour mieux répondre aux besoins des exploitants. Pourtant, en 2020, seules 18 % des surfaces assurables étaient couvertes par une MRC. Ce chiffre laisse entrevoir de fortes disparités : les productions les plus couvertes sont les grandes cultures (33 % des surfaces) et la viticulture (34 %), mais la mayonnaise ne prend pas en arboriculture (3 %) ni en prairies (1 %). La raison est simple, indique le directeur du marché de l’agriculture de Pacifica (Crédit Agricole), Jean-Michel Geeraert : « Le développement des offres assurantielles en arboriculture et prairies n’a pas pu se réaliser du fait de la concurrence avec le fonds de calamités agricoles ».
Créé en 1964, le régime des calamités est alimenté par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Il permet de réparer les pertes de récolte et de fonds d’origine climatique. En 2009 et 2011, les grandes cultures et la viticulture sont sorties du champ des calamités agricoles car les taux de souscription à la MRC étant relativement bons (27,6 % et 15,8 %), l’État a considéré que ces productions étaient désormais assurables. Par la suite, sans le filet de sécurité des calamités, la MRC a continué à faire des émules.
À l’inverse, les prairies et l’arboriculture demeurent jusqu’à aujourd’hui dans le champ des calamités agricoles car les taux de souscription à la MRC sont tellement bas que ces productions sont considérées non assurables. Arboriculteurs et éleveurs préfèrent en effet le régime d’indemnisation gratuit (les calamités) à l’assurance payante (MRC), deux dispositifs exclusifs l’un de l’autre. Il faut dire que côté arboriculture, le coût de l’assurance est élevé : en 2016, la prime (cotisation) moyenne restant à charge d’un arboriculteur était de 640 euros par hectare. Or, beaucoup avaient déjà souscrit à une assurance contre la grêle ou investi dans des moyens de protection. En prairies en revanche, la prime moyenne restant à charge d’un éleveur était de 11 euros par hectare. Un prix qui semble imbattable, comparé à ce qui était pratiqué en céréales (22 euros/ha) et en viticulture (165 euros/ha).
Un nouveau schéma public-privé
D’où l’idée de refondre le système pour continuer à développer l’assurance, mais en rendant le dispositif plus équitable. Missionné sur le sujet par le ministère de l’Agriculture, le député Frédéric Descrozaille érige, dans un rapport rendu le 21 avril 2021, un nouveau système d’intervention publique-privée. Il préconise de distinguer les risques assurables des risques non assurables dans toutes les filières. Les premiers seraient pris en charge par les assureurs, les seconds par l’État, le tout dans des conditions très incitatives pour les agriculteurs sans pour autant rendre la MRC obligatoire.
Ce rapport, qui préfigure plusieurs grandes lignes de la réforme, s’est prolongé d’un second rapport plus détaillé issu d’un groupe de travail organisé dans le cadre du Varenne agricole de l’eau, et remis le 28 juillet 2021 par le même Frédéric Descrozaille. Entre-temps, le dramatique épisode de gel au printemps 2021 n’a fait que légitimer la refonte du système : face à l’ampleur des pertes, l’État a engagé un plan de soutien de 1 milliard d’euros et réintégré exceptionnellement la viticulture au régime des calamités agricoles.
Depuis, la loi d’orientation du 2 mars 2022, une ordonnance du 29 juillet et une série d’annonces de l’Élysée et de Matignon en septembre ont largement concrétisé le plan stratégique (2023-2030) proposé dans le deuxième rapport Descrozaille.
Le futur dispositif de gestion des risques, qui entrera en vigueur en janvier, a été pensé pour atteindre un taux ambitieux de pénétration de la MRC par groupe de cultures (voir tableau). Il se scinde en trois niveaux. Le premier niveau correspond à la part de risques considérée comme supportable par l’agriculteur. Le deuxième niveau correspond à la part de risques « moyens » ou « modérés », pouvant être confiée aux assureurs via un contrat de MRC. Le troisième niveau correspond à la part de risques « catastrophiques » ou « exceptionnels », assumée par l’État via la solidarité nationale.
Soutien décuplé aux assurés
Pour inciter les agriculteurs à s’assurer, l’État augmente de manière inédite le soutien public à la MRC. Le taux de subvention à la prime d’assurance (cotisation) passe à 70 % (au lieu de 65 % actuellement), dès 20 % de pertes (au lieu de 30 %). Cela signifie que « toutes choses égales par ailleurs, à partir du 1er janvier 2023, le reste à charge pour un agriculteur sera moindre avec la réforme que sans la réforme », souligne Pascal Viné.
Pour favoriser la lisibilité du dispositif, le seuil de pertes qui déclenche l’assurance est désormais aligné sur le niveau de franchise. Bien entendu, un agriculteur peut s’il le souhaite se contenter d’un seuil de déclenchement supérieur à 20 % (par exemple 25 % ou 30 %), tout dépend du reste à charge qu’il est prêt à débourser. En tous les cas, cet effort financier de l’État est considérable. Il revient à appliquer dans les limites du possible le règlement européen Omnibus, ce qui était demandé de longue date par la FNSEA.
L’État s’engage aussi à indemniser les pertes catastrophiques de tous les agriculteurs. Mais l’ampleur de ce soutien public est conditionnée à la MRC. En effet, l’État prendra en charge 90 % des pertes exceptionnelles des agriculteurs assurés (les 10 % restants relèveront des assureurs). En revanche, l’État ne prendra en charge que 45 % des pertes exceptionnelles des agriculteurs non-assurés. Cette réduction de moitié de l’indemnisation publique vise à inciter les non-assurés à souscrire à une MRC. D’autant plus que ce taux sera dégressif dès la deuxième année de la réforme : il passera à 40 % en 2024, puis à 35 % en 2025.
Solidarité n’est pas calamités
Cette solidarité nationale sur les pertes catastrophiques marque un tournant dans l’engagement de la puissance publique car elle concerne désormais toutes les productions. Toutefois, les modalités entre filières sont différentes car la marche à franchir est particulièrement haute pour l’arboriculture et les prairies, accoutumées aux calamités agricoles. Pour faciliter la transition vers le nouveau système public-privé, l’État leur réserve un seuil de déclenchement de la solidarité nationale privilégié fixé à 30 %. C’est-à-dire qu’à partir de 30 % de pertes, l’État indemnisera les arboriculteurs et éleveurs victimes d’aléas climatiques. Pour les grandes cultures et la viticulture, le seuil d’intervention de l’État est fixé à 50 % de pertes.
Pour autant, la future solidarité nationale future n’équivaut pas aux actuelles calamités agricoles car le mode de calcul de l’indemnisation est fondamentalement différent, prévient la directrice assurances de Groupama Delphine Létendart. « Prenons l’exemple des prairies. Dans le régime actuel des calamités, l’éleveur doit avoir un taux de perte physique d’au moins 30 % pour être indemnisé. Ainsi, s’il a 31 % de pertes, on lui applique le taux d’indemnisation de 28 % sur tout son déficit fourrager (sous réserve d’une perte de 13 % de produit brut global). Demain, la solidarité nationale lui indemnisera 45 % de la perte prairie qui dépasse 30 %. En s’assurant, ce taux passera à 90 % ». Autrement dit, un éleveur ou un arboriculteur habitué aux calamités pourrait tomber de haut s’il se contentait de la solidarité nationale sans souscrire à une MRC. « On a un important travail de pédagogie à faire, dans les six prochains mois, pour que chaque agriculteur s’interroge sur la gestion des risques climatiques sur son exploitation : est-ce que la solidarité nationale lui suffira ? Ou a-t-il besoin d’améliorer sa résilience en souscrivant un contrat d’assurance qui le couvrira pour des pertes fortes et moyennes ? », poursuit Delphine Létendart.
Budget multiplié par deux
Ces différents seuils et taux seront confirmés prochainement par décret. Ils sont censés être gravés dans le marbre pendant les trois premières années de la réforme (2023-2025), comme le prévoit l’article 9 de la loi d’orientation. Mais, une « clause de revoyure » annuelle, confirmée par le président de la République, permettra d’envisager des réajustements, notamment en cas de dépassement de budget. Ce rendez-vous sera organisé par la Codar (commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes), nouvelle entité créée par la loi d’orientation, qui est chargée de formuler chaque année des recommandations pluriannuelles sur les seuils et taux.
Car pour mener cette réforme à bien, le budget dédié à la gestion des risques sera doublé : il passe de 280 millions d’euros (M€) à 600 M€ par an, et pourra aller jusqu’à 680 M€. Il se décompose en trois sources de financement : les fonds européens Feader à hauteur (184 M€) ; la contribution additionnelle des agriculteurs sur les assurances (120 M€) ; et le budget de l’État, ajustable, qui comprend la part actuellement affectée aux calamités agricoles via le FNGRA (laquelle était de 150 M€ en 2020).
Cet effort financier de l’État vise aussi à alléger la facture des assureurs qui d’un côté souhaitent développer la MRC au bénéfice de la profession, vu l’accélération des aléas climatiques ; et d’un autre côté affirment perdre de l’argent sur ce produit assurantiel. En effet depuis 2016, le rapport sinistre à primes de l’assurance MRC est régulièrement supérieur à 100 %, alors qu’il devrait être aux alentours de 70 % selon les assureurs. « Notre souci, c’est l’équilibre technique. Le but n’est pas de gagner de l’argent, mais d’arrêter d’en perdre. C’est une condition essentielle pour assurer la pérennité de la réforme », résume Pascal Viné.