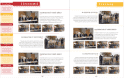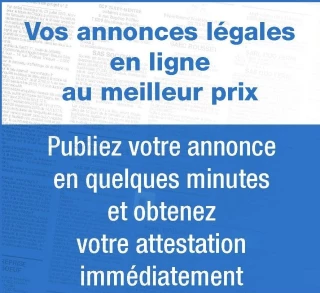« Le virus de l’influenza s’est adapté et est devenu plus pathogène »
Un virus plus mortel pour les galliformes, une excrétion jusqu’à quinze jours avant les symptômes chez les canards : dans un entretien accordé le 29 mars à Agra Presse, Gilles Salvat, de l’Anses, livre les premiers résultats des analyses sur l’épizootie d’influenza aviaire en cours dans l’Ouest.

Que sait-on du virus de l’influenza aviaire présent dans l’Ouest ?
Les séquençages montrent que huit génotypes du virus H5N1 ont circulé en France depuis l’hiver. Chez le FR2, présent en Vendée, nous avons détecté une mutation signe d’une adaptation aux oiseaux domestiques : le virus est devenu plus pathogène, en particulier chez les galliformes. Il provoque une mortalité foudroyante chez ces volailles, surtout chez les dindes, où il peut être létal à 100 % en moins de 48 heures.
Chez les volailles domestiques, ce virus est-il excrété avant les symptômes, comme cela a été observé dans le Sud-Ouest en 2021 et 2022 ?
Oui, surtout chez les canards. Cette excrétion durant la période prépatente peut débuter sept, dix, voire quinze jours avant les symptômes. Ce qui complique fortement la lutte : quand on a détecté un foyer à Malaussanne (Pyrénées-Atlantiques) fin décembre, les canards avaient déjà contaminé massivement l’environnement. On a pu prouver que 29 cas y étaient liés.
Comment le virus a-t-il été introduit en Vendée ?
Outre la confirmation des cas, le laboratoire national de référence réalise entre 30 et 60 séquençages par semaine. Les mutations que nous observons permettent de reconstruire les chaînes de transmission et de corroborer les enquêtes de nos deux épidémiologistes sur le terrain. Nous commençons à avoir un scénario crédible, avec une probable introduction par la faune sauvage migratoire remontante, ou par des oiseaux locaux contaminés par cette faune. Les oiseaux ont pu fuir les côtes, repoussés par les tempêtes du 18 et du 21 février. Il a pu y avoir une contamination de l’environnement, les oiseaux étant attirés par les labours ou les épandages. Dimanche 27 février, dix cas simultanés ont été confirmés dans des élevages, dont cinq le long de la D137, qui dessert le "hub" des Essarts. Il y a un trafic intense sur cette route où sont situés des usines d’aliment, des abattoirs, des couvoirs et des élevages.
Après cette introduction, comment s’est diffusé le virus ?
Il y a eu ensuite une propagation classique en tache d’huile autour des foyers. Celle-ci a pu se faire par voie indirecte : entraide entre agriculteurs, prêts de matériel, équipes d’attrapeurs communes, tournées de camions, etc. Des transmissions ont aussi pu se produire par voie aéroportée entre élevages proches : une volaille en incubation produit des dizaines, voire des centaines de milliards de virus. Des poussières ou duvets contaminés peuvent ainsi être transportés jusqu’à 500 mètres. Même après les tempêtes, les vents sont restés forts, jusqu’à 60 km/h. Ces nuages de poussières contaminées ont pu entrer dans les bâtiments par la ventilation, car les élevages ne sont pas équipés de systèmes de filtration d’air.
Reste-t-il des zones d’ombre dans cette enquête épidémiologique ?
La seule chose qui nous manque, c’est d’avoir trouvé des oiseaux migrateurs remontants positifs à l’influenza. En revanche, il y a eu des hérons garde-bœufs malades dans l’Ouest (et aussi, après cet entretien, des oies, goélands, mouettes et verdiers, le tout en Vendée, NDLR). Or, ces oiseaux autochtones ne migrent pas systématiquement. Il est vraisemblable que la contamination puisse persister dans la faune autochtone, qui peut ensuite jouer le rôle de relais. Il y a un risque d’endémisation de la maladie par la faune sauvage, mais aussi via une survie du virus dans l’environnement.
Par quel autre mécanisme ?
Il faudra au moins trois mois pour assainir la zone des Pays de la Loire élargie. Dans ce vaste secteur très massivement contaminé, il est très compliqué pour les DDPP et les organisations d’éleveurs de gérer les animaux morts en évitant les contaminations. Une fois le dernier oiseau malade éliminé et les élevages nettoyés, le virus peut encore survivre dans les lisiers. Notre avis rendu la semaine [du 21 mars, NDLR] montre qu’il faut un à deux mois, en fonction des températures extérieures, pour décontaminer le lisier. Or les élevages touchés sont plutôt importants et génèrent de grosses quantités de lisier. Vu la dynamique actuelle, il y a un risque de faire la jonction jusqu’à l’hiver. La situation est extrêmement préoccupante.
La gravité et la rapidité de l’épizootie dans l’Ouest semblent avoir surpris professionnels comme pouvoirs publics…
On ne pensait pas être confrontés à cette crise sans précédent. L’arrivée de l’influenza en Vendée est ce qui pouvait arriver de pire : tous les opérateurs de la filière y sont concentrés dans un secteur relativement réduit. Il y aura probablement des enseignements à tirer en termes d’organisation de la filière, notamment pour mieux protéger la génétique. On touche peut-être les limites de la concentration des élevages.
Arrive-t-on aux limites de la biosécurité ?
C’est un reproche qu’on nous fait : nous avons formulé des recommandations très fortes pour le renforcement de la biosécurité et la mise à l’abri des animaux en période à risque. Certains éleveurs ont acheté des bâtiments et disent que la biosécurité ne fonctionne pas car ils sont touchés par l’influenza. Mais mise à l’abri ne veut pas dire biosécurité. Des enquêtes dans le Sud-Ouest ont montré que, pour repailler les bâtiments – une opération réalisée quotidiennement quand les animaux sont à l’abri –, les éleveurs sortent les animaux sur un parcours réduit, faute de place pour le faire en laissant les animaux dans le bâtiment. Dans ce cas, la mise à l’abri n’est pas complète. Nous insistons aussi beaucoup sur les risques liés aux contaminations indirectes : mauvaises pratiques pour rentrer dans les bâtiments (pas de changement systématique de chaussures et de tenue par exemple), échanges de matériel, entraide ou mouvements de personnel, transports d’animaux et d’œufs à couver, etc. Dans un environnement massivement contaminé, comme c’est le cas dans l’Ouest aujourd’hui, la biosécurité seule ne suffira pas.
Que faire alors ?
Une piste serait de parvenir à faire des dépistages réguliers. Le projet européen Vivaldi vise à élaborer des autotests fiables à réaliser par les éleveurs ou les vétérinaires. Détecter les animaux excréteurs avant les symptômes nous donnerait un vrai avantage : gagner quatre ou cinq jours sur le virus permettrait d’éviter plusieurs dizaines de cas de réplique. Pour l’instant, il n’y a pas encore de méthode aboutie. L’enjeu est d’arriver à un diagnostic suffisamment fiable et rapide.
Les éleveurs attendent aussi beaucoup de la vaccination…
Nous sommes en train de finaliser le protocole de l’expérimentation, avant de tester deux candidats-vaccins sur des lots d’une centaine d’animaux, à deux âges différents. Cet essai, mené avec l’École nationale vétérinaire de Toulouse, ne vise pas à prévenir les symptômes, mais à ralentir la propagation de la maladie. On cherche à tester si le vaccin permet de diminuer l’excrétion et la transmissibilité du virus, et de combien il retarde sa diffusion. Un des critères est de pouvoir différencier à coup sûr les animaux infectés et les animaux sains par la méthode Diva, afin de rassurer nos clients à l’export. Le vaccin ne sera pas disponible cet hiver : il faut en général compter un an pour obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un produit déjà au point.