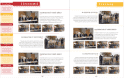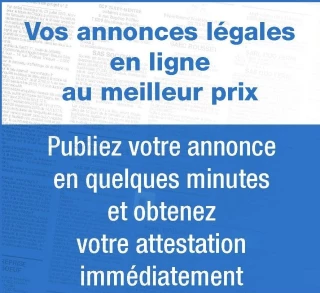EXCLU WEB : Les clés des succès du secteur bio français
En vingt ans, la France est passée de la quatorzième place au premier rang des nations bio en Europe. Une lente construction de marché, qui a bénéficié d’aides revalorisées suite à la réforme de la Pac de 2013, de l’intérêt croissant de l’agroalimentaire et de la distribution, mais également du progrès technique et des crises des filières agricoles conventionnelles. Pourtant, à l’heure des embouteillages sur certains marchés comme le lait et l’œuf, le bio doit trouver de nouvelles pistes pour maintenir sa croissance à deux chiffres. Pour ce faire, deux propositions politiques sont sur la table : la FNSEA plaide pour davantage de contractualisation, et la Fnab pour un soutien renforcé à la demande. Les deux camps s’entendent sur la revalorisation du crédit d’impôt bio, qui a été adoptée à l’Assemblée pour 2022.

« Nous sommes désormais dans la cour des grands », s’est réjouie Laure Verdeau, directrice de l’Agence bio, à l’occasion des vingt ans de son organisation le 14 octobre. En deux décennies, a-t-elle illustré, la SAU bio française est passée de 300 000 hectares à plus de 2,5 millions d’hectares, soit 9,5 % de la SAU nationale. Faisant de la France, depuis juillet, le premier pays bio de l’Union européenne en termes de surface. Mais l’hexagone s’illustre aussi depuis quelques années sur le podium européen de la consommation bio, avec un chiffre d’affaires français passé de 7 milliards à 12,7 milliards d’euros entre 2015 et 2020, ce qui en fait le deuxième marché européen.
Alors que la bio est devenu un marché à part entière, le regard du monde agricole a, lui aussi, évolué. « Au début, dans les organes où je siégeais, à la FNSEA ou dans les chambres, ce n’était pas toujours facile », reconnaît Étienne Gangneron, vice-président de la FNSEA en charge du bio, et ancien président de l’Agence bio entre 2013 et 2015. « Quand nous avons converti la ferme, début 2000, nous nous inscrivions dans une forme de marginalité. Mais la frontière s’est peu à peu brisée autour des pratiques culturales », complète Philippe Camburet, président de la Fnab.
En vingt ans, le bio peut donc revendiquer un succès à la fois économique, technique, et culturel. Un virage qui ne doit rien au hasard, selon Étienne Gangneron, pour qui « la bio en France a été construite pour le consommateur français ». Quatre principaux facteurs y ont contribué : les politiques publiques, notamment le coup de pouce donné par la Pac de 2013, le progrès technique, l’attrait de la promesse du bio chez le consommateur et les crises des filières conventionnelles. Retour sur l’histoire d’un succès.
Le tournant de 2013
L’Etat a un rôle majeur dans l’essor de la bio. Avec la création du label officiel AB en 1985, la France a été un pays précurseur en Europe. Mais c’est le règlement européen de 1991 qui, en uniformisant la bio en Europe, « a facilité en France le passage d’un marché d’export vers le marché intérieur », retrace Michel Reynaud, président d’Ecocert et de l’Ifoam. Pourtant, à la fin des années 1990 avec moins de 0,5 % de ses terres en agriculture biologique, la France est encore le quatorzième pays en termes de bio sur les quinze membres que compte l’Union européenne à cette époque.
Comme le montre l’évolution des surfaces (voir notre graphique), un premier effort budgétaire portant les aides à la conversion de 15 à 60 millions de francs en 1997 propulse rapidement les surfaces bio à 580 000 ha environ vers 2003. La croissance ne reprend ensuite qu’en 2009, avec le bilan de santé de la Pac, qui fera passer la SAU bio à 1,1 million d’hectares. Une dynamique accélérée pour de bon à partir de 2013 par la réforme de la politique européenne. « C’est cette programmation qui a modifié les règles du jeu », appuie Étienne Gangneron.
À regarder l’enveloppe dans son ensemble, ce n’est pas évident. Car avec près de 5 % des aides du Feader dédiées à la conversion et au maintien, quand la moyenne des États membres est à 6,4 %, la France ne fournit pas alors un effort budgétaire annuel particulièrement élevé. Mais dans le détail, les montants des aides surfaciques sont toutefois significativement révisés à la hausse, passant de 100 à 130 €/ha/an pour les prairies permanentes, de 200 à 300 €/ha/an en cultures annuelles, et de 300 à 900 €/ha pour les PPAM2. Et comme le rappelle une étude d’Ifoam Europe de 2017, la France fait surtout le même choix structurant que certaines autres régions en Espagne ou en Italie, en allongeant la durée des aides au maintien de 3 à 5 ans.
Le ralliement des grandes cultures
Tout au long des vingt dernières années, les gouvernements ont tenté d’encadrer le développement de la bio par des plans successifs. D’abord en 1998, avec le plan pluriannuel de développement de l’AB (PPDAB) de Louis Le Pensec (PS). Un premier essai suivi en 2008 du programme « Agriculture biologique : Horizon 2012 » de Michel Barnier (RPR), puis en 2013 du plan Ambition bio 2017 de Stéphane Le Foll (PS), et récemment prolongé en 2018 par le plan Ambition bio 2022 de Stéphane Travert (LREM).
« Ces plans n’ont connu que des succès très relatifs ou, si l’on préfère, ont essuyé des échecs répétés », tranchait le Sénat dans un rapport d’information publié en janvier 2020. Principal reproche de la chambre haute : des cibles de surface toutes aussi « irréalistes », et qui n’ont jamais été atteintes.
Alors que les fourrages bio progressaient rapidement, atteignant déjà 300 000 ha en 2005, les objectifs nationaux de surface ont longtemps buté sur les grandes cultures. Et pour Étienne Gangneron, la hausse significative en grandes cultures ne serait observée que « depuis trois ou quatre ans ». Une accélération directement facilitée par la revalorisation des aides, mais aussi de manière plus détournée par d’autres évolutions de la Pac. « La réglementation sur l’implantation des couverts a fait revenir beaucoup d’espèces dans le paysage, et les gens se sont par exemple mis à semer du lin, des lentilles », observe Philippe Camburet, au sein de la Fnab.
Le récent intérêt des grandes cultures s’expliquerait également par la diffusion des techniques en matière de désherbage, ou de gestion des couverts, qui ont elles aussi facilité les conversions. « Avec le premier salon Tech & bio organisé par les chambres en 2007, on a senti un vrai changement, avec une réponse de terrain aux attentes des producteurs », se souvient Michel Reynaud chez Ecocert. Autre facteur de taille, selon Christine Valentin, première vice-présidente de l’APCA et présidente de la chambre de la Lozère : la « grosse demande de la part des filières animales, qui ont ouvert de nouveaux marchés ».
Une industrie au rendez-vous
Des crises d’origines diverses auraient également joué un rôle central dans le développement de la production et la consommation. Comme la chute des cours de certains produits agricoles à la fin des années 2000, qui a poussé de nombreux producteurs à la conversion. « En lait, nous avons été tellement mis à mal en 2009 qu’il fallait prendre un virage, et certains ont fait le choix du bio », se souvient Christiane Valentin. Parallèlement, après ces scandales comme la vache folle ou les dioxines, « le consommateur avait besoin d’être rassuré », rappelle Laure Verdeau à l’Agence bio.
« Il ne faut pas oublier que les conversions chez les PME font aussi partie de cette évolution », souligne Didier Perreol, président du Synabio et fondateur d’Ekibio. Selon les chiffres de l’Agence bio, le nombre d’entreprises dans la transformation, la distribution ou encore l’import-export serait ainsi passé de moins de 5 000 en 2005, à près de 26 000 en 2020. « Dans tous les pays les plus avancés sur le bio, comme l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne, on retrouve cette dynamique de l’aval qui participe de manière très forte au développement », appuie Michel Reynaud.
L’engouement des transformateurs serait dû lui aussi aux aides à la conversion chez les agriculteurs, qui ont apporté un flux de matière première, mais également aux garanties apportées par le fonds Avenir bio. Dédié aux projets de filière, ce fonds aurait accordé près de 50 millions d’euros à des projets de filières depuis sa création en 2008. Une somme qui parait faible sur un marché à 13 milliards d’euros, mais qui a permis, « de fédérer des euros publics », insiste Laure Verdeau, à l’Agence bio, évoquant les cofinancements des régions ou des collectivités.
Mais comme dans le secteur agricole, souligne Didier Perreol, le bio a aussi été un moyen pour la transformation de trouver un nouveau souffle financier. Comme il le rappelle, « pour de nombreuses PME en milieu rural, la conversion est un moyen de survivre face aux gros groupes agroalimentaires ». Pourtant, dans l’ensemble de la filière, alors que la grande distribution capte la plus grande part de la croissance bio, et que les prix de certaines productions subissent à leur tour les fluctuations observées dans le conventionnel, cette sécurité économique semble de plus en plus incertaine.
IL
Bio : la liste des productions recherchées par les transformateurs
Début novembre, le Synabio, syndicat des entreprises spécialisées de l’aval, a publié une liste des produits agricoles recherchés par ses adhérents. La plupart concernent la filière fruits et légumes, comme les tomates, les fraises, les pommes, les agrumes, ou encore les épinards, les figues et le cassis. Mais le Synabio serait également intéressé par des produits comme le lait de chèvre, le fromage de vache ou encore le miel et les plantes aromatiques en général. Côté grandes cultures, le Synabio recherche également plusieurs céréales et oléagineuses dont les blés anciens, l’avoine et même le colza. « Contrairement à ce que l’on a tendance à entendre ces derniers temps, le marché bio est dynamique du côté des transformateurs », assure un communiqué envoyé le 10 novembre, évoquant « de nombreux besoins en matières premières de la part des entreprises ». La liste est assortie d’une charte par laquelle les adhérents du Synabio s’engagent sur un modèle de filière « exigeant, transparent, responsable et solidaire ». Des objectifs qui se traduisent par une traçabilité précise et des contrats pluri-annuels, voire idéalement « par une labellisation commerce équitable ».