Le plan de vol BDS-2030 en 7 escales
Pour continuer à filer la métaphore des vols aéronautiques (lire notre précédente édition), Bourgogne du Sud a donné son plan de vol à ses passagers après l’embarquement dans son assemblée générale, le 6 décembre dernier à Beaune. Et le capitaine instructeur de ce vol inaugural n’était autre que Virginie Guyot, pilote de chasse dans l’armée de l’air et première femme à être leader de la patrouille de France.
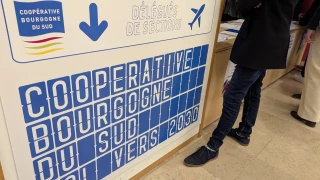
Première escale annoncée par le directeur de Bourgogne du Sud, Bertrand Combemorel, « œuvrer pour l’implication de nos coopérateurs ». Et cela commence par « l’implication du conseil d’administration », qui est une véritable cabine de pilotage. Les instruments de pilotage sont de plus en plus modernes, pas forcément plus compliqués, mais avec de nouvelles consignes de vols. C’est pourquoi la coopérative s’évertue à chercher « un renouvellement normal par des jeunes », toujours en veillant bien à la représentativité des métiers, ici, comprendre des principales productions : cultures, élevages, viticulture… Ce qui amène tout naturellement à la deuxième escale : « assurer la pérennité du modèle économique », s’entendant des coopérateurs, de la coopérative et de tous ces projets, partenariats et filiales. À l’image de la « reprise d’Avéal » dans le « prolongement évident du territoire historique » mais avec une efficacité logistique accrue, « sans aller au-delà du raisonnable », et laissant la main aux coopératives de l’Allier et de la Loire, ainsi qu’à Nicot-Philicot pour la partie nutrition animale. Car pour arriver à bon port à la troisième escale, à savoir « valoriser les productions de nos coopérateurs », il faut savoir se reposer sur le savoir-faire d’expert et se diriger de plus en plus vers la qualité. « 49 % de la récolte livrée a été avec un contrat d’une de nos diverses chartes de qualité, en colza, tournesol, orge de brasserie, blé… », n’oubliant aucune des grandes cultures présentes. Preuve que les céréaliers aussi ne livrent plus simplement des matières premières pour des filières longues. « Ce n’est pas une fin en soi, car l’objectif, reste d’aller chercher chez nos clients-transformateurs de la valeur ajoutée », que Bertrand Combemorel a chiffrée à une moyenne de + 9,70€ la tonne pour les adhérents. Et ce n’est pas tout, avec les autres partenaires de la coopérative jouant le jeu, des contrats pluriannuels « Agri éthique », prennent en compte la « rémunération de l’exploitant », genre de loi Egalim prenant en compte les coûts de production, pour une rémunération juste du producteur. Enfin, comment ne pas citer Extrusel qui « touche positivement le monde de l’élevage » pour produire des tourteaux locaux non-OGM. Depuis le confinement Covid, qui a prouvé que des ruptures des flux sont imaginables, l’outil est saturé. C’est aussi la force d’achat avec Aréa qui a permis d’obtenir des verriers, les bouteilles nécessaires à l’embouteillage.
Quatrième escale au sol et même dans les sols, pour « impulser la révolution agronomique ». Là encore, la mutualisation dans chaque coopérative au sein d’Alliance BFC a permis une « recherche et développement avec plus d’expertises » encore. Ses essais se transformeront en cultures à forte valeur ajoutée. Mais la production aujourd’hui, comme hier, n’est pas que physique, elle est aussi informationnelle. Cerevia le sait. Pour la partie aval, la commercialisation des céréales, aujourd’hui et encore plus demain, ce seront les « data » sur les fermes qui seront le « nouveau pétrole de demain », comme le nomment les experts en Intelligence artificielle. Sauf que la coopérative avec Alliance BFC compte bien faire en sorte que la valeur reste aux coopérateurs, qui sont maîtres de leurs données. Autre exemple d’utilisation des données, les prévisions météo et les outils d’aides à la décision pour prévoir et traiter les maladies, du type oïdium et mildiou.
D’où une cinquième escale pour faire le plein et « conserver notre proximité territoriale ». Là, les investissements peuvent être importants pour ne pas perdre en compétitivité. « On refait nos sites de collecte, pour réduire le temps d’attente ou pour des systèmes de nettoyage des cellules, refroidies car nous ne pouvons plus utiliser des pesticides ». Des investissements qui ont en face « de la valeur ajoutée » pour les clients et vice-versa. La filiale viticole Fichet à Meursault (21) sera regroupée sur un seul site, modernisé avec un atelier chaudronnerie. Ou comme à Curciat (01) pour que l’usine d’aliments Moulin Jeannet soit « digne des standards actuels ».
Petite nouveauté, relative, pour la coopérative, l’escale récente « faire savoir nos savoir-faire ». La coopérative a « structuré » sa communication, « pilotée par huit adhérents ». Une communication qui commence par informer les adhérents. Mais aussi en direction du grand public, « pour dédiaboliser la production française », avec la marque Nous autrement notamment, mais aussi à travers la pédagogie lors de visites de collèges et de lycées, sur des manifestations grand public, par des vidéos sur les réseaux sociaux… permettant aussi de développer « notre marque employeur » en vue de recruter.
C’est l’ultime étape du voyage, « impliquer nos salariés ». Car ces derniers, 200, ont aussi des idées et des solutions à proposer. « Leur implication s’est vue lors des aléas 2024 », soulignait et les remerciait, le directeur. Bertrand Combemorel concluait ce vol inaugural en laissant la parole au « commandant de bord », Lionel Borey, le président qui cédait les commandes à Virginie Guyot pour « prendre de la hauteur et rêver à la patrouille BDS ». Direction 2030 maintenant.
Virginie Guyot : la confiance mutuelle pour « faire face ensemble »

Asseyez-vous tranquillement dans le siège arrière de l’Alpha Jet de la patrouille de France. Pour pilote, Virginie Guyot, première femme pilote de chasse à 25 ans, première affectée sur mirage F1CR, première femme leader de la patrouille de France en 2010… Mais, ce parcours hors norme, Virginie Guyot ne le doit pas à son genre, mais à son travail, sa rigueur, sa persévérance, son intelligence… et ses coéquipiers. D’autant qu’elle a effectué de nombreuses missions de guerre, en de multiples lieux de conflits.
Mais à l’AG de Bourgogne du Sud, cette « femme en Or Olympique », emmenait les 500 passagers du jour pour un entraînement de haut vol, tant sa conférence a captivé et a résonné chez les chef (fe) s d’exploitation agricole et viticole. « Vous êtes avec moi, à l’arrière de mon Alpha Jet, au-dessus de Salon-de-Provence (base aérienne de la Patrouille de France, N.D.L.R.). On part en piqué à 400 km/h, la vitesse augmente, le filet d’air fait vibrer la carlingue. Les avions de Taz et Tonio à côté sont nerveux aussi, car en accélération vers 700 km/h », nous plonge-t-elle dans son métier. Une professionnelle qui annonce alors à la radio les commandes à suivre. « Cadence ». À ce moment, il faut faire une figure et faire un rase-mottes à 100 m du sol, pour montrer le ventre des avions au public et lâcher les fumées bleu-blanc-rouge. « On passe alors de 1G à 6G. Je passe de 50 kg à 300 kg. C’est un effort surhumain. On doit se concentrer sur sa respiration, serrer les abdos, pour que le sang continue d’aller au cerveau » malgré la combinaison anti-G, « sinon, on fait un cratère ». La figure bien passée, on rentre à la base, « vider d’énergie physique et nerveuse ». Pour autant, le travail n’est pas terminé. Au contraire. C’est au sol que le vol se prépare et se corrige. « La force d’un collectif, c’est un cap, une boussole, quand tout le monde regarde dans le même sens, reçoit la même info au même moment, pour aller à la même destination. Cela repose sur la confiance mutuelle ». Pour tout Français, c’est sans doute la partie la plus compliquée de notre culture critique et râleuse. « Il faut la cultiver tous les jours. La Patrouille de France n’est pas Top Gun, avec des égos surdimensionnés », remettait-elle les pieds sur terre à tout le monde. Ce qui prime, c’est « l’intelligence collective » et une équipe n’est pas qu’une somme d’individualité, mais plus de complémentarité. « Comme Cantona en équipe de France de foot. C’était le meilleur mais l’équipe était meilleure sans lui », lui a dit Aimé Jacquet. « Dans l’armée, on fonctionne avec des travailleurs de l’ombre : mécaniciens, secrétaires, contrôleurs… même si on n’est pas câblé pareil ». Pour arriver à travailler main dans la main, elle « sort de sa bulle de confort » pour prendre le temps de connaître et comprendre les autres. « Faire face », est la devise de Georges Guynemer, à laquelle, elle rajoute « ensemble ». Et pour progresser encore et toujours, le moment du débriefing après vol est primordial pour les pilotes. « On ne passe pas par quatre chemins pour se dire les choses et c’est appréciable ». Mais pas n’importe comment, avec méthode. Les derniers pilotes arrivés dans l’équipe parlent en premier pour ne pas « faire l’autruche » et ne pas s’autocensurer de peur des plus gradés. « Cela donne aussi une information sur la maturité de nos équipiers ». Même le, ici en l’occurrence, la leader doit admettre de faire des erreurs. « On ne débriefe pas que quand cela ne va pas, mais aussi pour capitaliser sur ce qui s’est bien passé ».
De quoi donner la confiance au prochain décollage, et même avant, lors du brief de décollage car « après à 700 km/h, on n’a pas le temps de philosopher ou débattre ». Même importance pour préparer les scenarii en cas de « dégradations météos, tactiques changées… ». Le ou la leader doit être clair et précis pour les expliquer afin de « rassurer ses équipiers et pour qu’ils comprennent mieux comment il prend ses décisions ». Et inversement, les autres ont le droit de donner des idées pour trouver les meilleures. « L’inverse de la hiérarchie qu’on imagine dans l’armée », cassait-elle une nouvelle idée reçue. Elle donnait donc un dernier conseil à la coopérative : « anticiper tout ce que vous pouvez, collecter info avant, maîtriser le vol et soyez prêts à être agiles dans le feu de l’action ».




