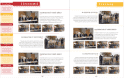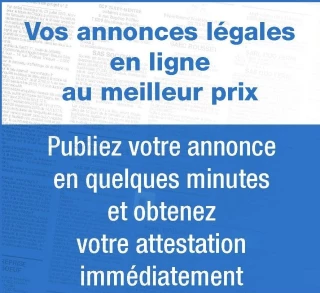Quand les médicaments manquent, les praticiens s’adaptent
En médecine humaine comme en médecine animale, les pénuries pharmaceutiques impactent le travail des praticiens. La médecine vétérinaire rurale s’adapte donc aux disponibilités fluctuantes d’antibiotiques ou d’allopathiques. Le point avec Pauline Otz, praticienne hospitalière en médecine de troupeau et encadrante à l’école nationale vétérinaire lyonnaise, VetAgroSup.

D’après Pauline Otz, dans toute formation vétérinaire, les élèves sont sensibilisés au plus tôt au manque de médicaments. « Tous sont formés à adapter la thérapeutique à toutes les contraintes, qu’elles soient liées à la disponibilité du médicament, à l’éleveur ou au type de maladie rencontrée », explique-t-elle. Il existe néanmoins des alternatives ou solutions de prévention, afin d’éviter l’urgence, et donc l’antibiothérapie.
Mieux vaut prévenir que guérir
« La délocalisation des usines de fabrication françaises de molécules princeps à l’étranger a grandement participé aux régulières pénuries de médicaments », constate Pauline Otz. Alors pour la praticienne, éviter de se retrouver dans une situation d’urgence, c’est aussi bien observer ses animaux : « les antibiotiques sont utilisés lorsque l’état de l’animal est critique. Les éleveurs doivent donc accorder une attention particulière aux premiers signes d’affaiblissement », explique-t-elle. « Une fois ces signes observés, l’éleveur doit mettre un suivi en place avec un vétérinaire. Cela permet d’éviter les stades où l’on n’a plus d’autre choix que les antibiotiques ». Un stade de gravité peu élevé permet en effet d’avoir recours à des médecines complémentaires : homéopathie, ostéopathie, phytothérapie (soins par les plantes) ou encore aromathérapie (soin par les huiles essentielles), les solutions sont pléthores pour agir en prévention. « Certaines molécules peuvent être remplacées, en cas de rupture : si l’on ne peut pas la remplacer, on va tenter de la substituer par un traitement destiné à une autre espèce. En dernier recours, on se tournera vers la thérapeutique humaine », explique Pauline Otz. Mais d’après la vétérinaire, les antibiotiques restent difficilement remplaçables, surtout lorsqu’il existe un seul fournisseur, en rupture pour le monde entier. « Le frein économique est une raison qui retient souvent les éleveurs d’appeler un vétérinaire dès les premiers signes de maladie. Mais c’est une réaction qui retarde simplement l’urgence », déplore la praticienne.
La biosécurité
Bien avant les soins en prévention ou la médecine complémentaire, la biosécurité reste la clef de voûte de la sécurité sanitaire. « Elle représente un contrôle permanent à plusieurs niveaux : analyser les animaux qui entrent dans un troupeau, contrôler les entrées et sorties des personnes extérieures à l’élevage (vétérinaires, marchands, inséminateurs), prendre des précautions avec les mélanges d’animaux, avec les pâturages… Il existe énormément de mesures à mettre en place, selon l’élevage, sa taille, les espèces », relate la vétérinaire. « Lorsqu’elles sont bien respectées, on évite drastiquement l’apparition de maladies ». D’après Pauline Otz, certaines espèces sont plus sensibles aux maladies que d’autres. « En volailles par exemple, il y a énormément de règles. On n’entre pas dans un poulailler sans avoir désinfecté les bottes à l’aide d’un pédiluve, ou sans porter un équipement spécifique », précise-t-elle. Pour le matériel en Cuma, la désinfection est de rigueur. « Prendre une bétaillère en Cuma, qui a déjà été utilisée par d’autres éleveurs, il faut prendre ses précautions pour ne pas s’exposer à des risques ».