Des questions réglementaires en suspens suite à l'expérimentation de "Vins de France" en Bresse
La Maison de négoce Boisset souhaite relocaliser ses approvisionnements en raisins de base pour ses vins mousseux. Pour mesurer la faisabilité économique, une quinzaine d’agriculteurs de Bresse vont tenter l’expérience. La profession viticole surveille de près ce dossier car il pose des questions sur la réglementation nationale.
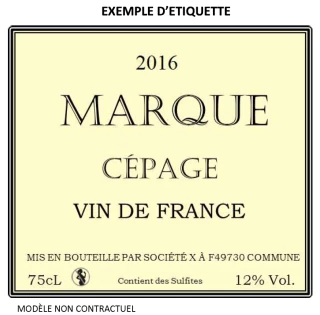
En 2016, la France a importé un nouveau record de 7,5 millions d’hectolitres (Mhl) de vins étrangers dont 6,15 millions en vrac, principalement venus d’Espagne (5,5 Mhl ; 248 millions d’€). De nombreux acteurs –Négoces ou Caves coopératives– conditionnent d’ailleurs en Bourgogne ces vins sans indication géographique (VSIG). Le groupe Boisset à Nuits-Saint-Georges (Côte d’or) en fait partie.
Pour beaucoup, ce "trou" des VSIG dans la balance commerciale française apparaît comme une fatalité, la compétitivité nationale étant accusée d’être immanquablement battue par d’autres pays. Et si ce n’était pas vrai ? Et si il était possible d’inverser les choses ? Certains y croient. Boisset en tête. Le négociant s’est donc naturellement rapproché d’un acteur local capable de répondre à cette double problématique : économique et technique.
Une expérimentation
La coopérative Bourgogne du Sud a répondu par la positive pour tester la faisabilité d’un tel projet. Elle a le savoir-faire et les infrastructures pour produire ces raisins régis par le cahier des charges des vins de France.
Du côté de la Draaf Bourgogne Franche-Comté et de FranceAgriMer à Dijon, des demandes d’autorisation de plantation pour des VSIG ont été réalisées dans des proportions « plus conséquentes » que les années passées. 89 hectares (ha) sur l’ensemble du bassin Bourgogne-Beaujolais-Jura-Savoie. 65 ha ont été autorisés en vue de plantations en plaine de Saône lors de cette campagne 2017/2018. Une quinzaine d’exploitations se lanceraient ainsi dans la culture de la vigne autour de Pierre de Bresse ou encore à Saint-Loup-Géanges. L’expérimentation prévoit onze cépages différents, dont le chardonnay, le colombard, l’ugni blanc…
Cette expérimentation soulève toutefois des questions à la profession viticole. Elle soulève également des inquiétudes au sein de la famille bourguignonne du négoce, révélée au grand jour lors de la conférence de presse du BIVB (lire notre édition du 29 septembre en page 12).
La Fédération des caves coopératives, par la voie de son président, Marc Sangoy, se dit « inquiet » par cette « expérimentation qui, si elle s’avère positive, pourrait aller jusqu’à 180 ha de vignes, dont 30 ha de chardonnay ». Il s’agit évidemment de vignes à « faible densité » mais aux potentiels de rendements « impressionnants ». Les exploitants visant entre 120 à 140 hl/ha, selon les cépages. Un objectif techniquement possible avec la ferti-irrigation. La production serait ensuite destinée à la confection de vins mousseux par la Maison Boisset. Il est à noter que le négociant nuiton s’approvisionne pour l’heure d'autres bassins de production ou en Espagne pour élaborer ce type de produit…
Des questions réglementaires
Du côté de la Confédération des appellations et vins de Bourgogne (CAVB), son président, Jean-Michel Aubinel, par ailleurs vice-président de la Cnaoc, y voit une faille dans la réglementation viticole française. « C’est en effet un sujet délicat que ce développement de VSIG à proximité immédiate d’aires d’appellations d’origine contrôlée (AOC) », ajoute Jean-Michel Aubinel.
De fait, ce débat est sur la table depuis la libéralisation des droits de plantation devenus autorisations de plantation au 1er janvier 2016. La CAVB a certes essayé de créer une place aux représentants des VSIG au sein même de ses instances, lesquels représentants sont - pour le moment - uniquement organisés en Syndicat au niveau national. « Nous n’arrivons pas à savoir s’il existe un échelon régional », déplore le président de la CAVB.
Des idées pour d’autres
La véritable crainte de ce dernier serait de voir fleurir des parcelles de VSIG, dans parcelles à proximité, à côté ou même au milieu des zones délimitées des appellations de Bourgogne. « Avec du marketing et une bonne communication, il est facile d’induire les consommateurs non avertis en erreur, puisque ce seront des vins issus de vignes réellement plantées en Bourgogne au sens de la région administrative », reconnaît-il. « Le risque porte sur le détournement de notoriété des appellations », souligne le représentant des ODG d’appellations de Bourgogne.
Ce projet pourrait « donner des idées à d’autres opérateurs », même si ils n’en n’avaient pas réellement besoin. En effet, l’ensemble de la « chaîne » vitivinicole nécessaire est déjà présente et organisée en Bourgogne : matériels, sites, logistiques… Ce qui la rend compétitive ! « C’est plus simple de s’implanter ici que dans des zones éloignées ou isolées », analyse de fait Jean-Michel Aubinel. Les négociants ou les grands groupes vinicoles (Castel, Les Grands chais de France…) ayant tous envie de rapprocher la production de raisins de leurs sites de vinification. Déjà équipés, les vignerons ayant des parcelles situées dans des zones non AOC pourraient, eux aussi, être intéressés.
Le véritable problème réside dans l’organisation des contrôles adéquats qui s’en suivront. La charte des Vins de France interdit de fait déjà certaines mentions, tels que "Mis en bouteille à la propriété" ou "Mis en bouteille en région de production" qui sont des mentions réservées aux seules AOP et aux IGP.
De futurs contingents VSIG ?
Appelé à donner un avis sur ces autorisations de plantation et ainsi de définir la politique de vins de France dans notre région de production majoritairement AOP, le conseil de Bassin du 23 octobre devrait débattre - et pour la première fois - de l’opportunité ou non de mettre des « contingents futurs » sur les VSIG. La famille viticole et le négoce seront ainsi appelés à se positionner, mais seule l’administration aura le mot de la fin.
Ce projet –qui ne doit en aucun cas opposer les uns aux autres– se pose comme un cas concret de la nécessité d’une gestion territoriale collective au sujet de laquelle un consensus est attendu. Plus spécifiquement, il pose aussi la question de la gestion stratégique des autorisations de plantation alors que sa gouvernance par les seules ODG est toujours remise en cause par la famille Négoce qui réclame une co-gestion interprofessionnelle. Le refus de la famille viticole a, jusqu’à présent, été sans appel. La CAVB rétorquant qu’il s’agit de ses prérogatives.
Des questions réglementaires en suspens suite à l'expérimentation de "Vins de France" en Bresse

En 2016, la France a importé un nouveau record de 7,5 millions d’hectolitres (Mhl) de vins étrangers dont 6,15 millions en vrac, principalement venus d’Espagne (5,5 Mhl ; 248 millions d’€). De nombreux acteurs –Négoces ou Caves coopératives– conditionnent d’ailleurs en Bourgogne ces vins sans indication géographique (VSIG). Le groupe Boisset à Nuits-Saint-Georges (Côte d’or) en fait partie.
Pour beaucoup, ce "trou" des VSIG dans la balance commerciale française apparaît comme une fatalité, la compétitivité nationale étant accusée d’être immanquablement battue par d’autres pays. Et si ce n’était pas vrai ? Et si il était possible d’inverser les choses ? Certains y croient. Boisset en tête. Le négociant s’est donc naturellement rapproché d’un acteur local capable de répondre à cette double problématique : économique et technique.
Une expérimentation
La coopérative Bourgogne du Sud a répondu par la positive pour tester la faisabilité d’un tel projet. Elle a le savoir-faire et les infrastructures pour produire ces raisins régis par le cahier des charges des vins de France.
Du côté de la Draaf Bourgogne Franche-Comté et de FranceAgriMer à Dijon, des demandes d’autorisation de plantation pour des VSIG ont été réalisées dans des proportions « plus conséquentes » que les années passées. 89 hectares (ha) sur l’ensemble du bassin Bourgogne-Beaujolais-Jura-Savoie. 65 ha ont été autorisés en vue de plantations en plaine de Saône lors de cette campagne 2017/2018. Une quinzaine d’exploitations se lanceraient ainsi dans la culture de la vigne autour de Pierre de Bresse ou encore à Saint-Loup-Géanges. L’expérimentation prévoit onze cépages différents, dont le chardonnay, le colombard, l’ugni blanc…
Cette expérimentation soulève toutefois des questions à la profession viticole. Elle soulève également des inquiétudes au sein de la famille bourguignonne du négoce, révélée au grand jour lors de la conférence de presse du BIVB (lire notre édition du 29 septembre en page 12).
La Fédération des caves coopératives, par la voie de son président, Marc Sangoy, se dit « inquiet » par cette « expérimentation qui, si elle s’avère positive, pourrait aller jusqu’à 180 ha de vignes, dont 30 ha de chardonnay ». Il s’agit évidemment de vignes à « faible densité » mais aux potentiels de rendements « impressionnants ». Les exploitants visant entre 120 à 140 hl/ha, selon les cépages. Un objectif techniquement possible avec la ferti-irrigation. La production serait ensuite destinée à la confection de vins mousseux par la Maison Boisset. Il est à noter que le négociant nuiton s’approvisionne pour l’heure d'autres bassins de production ou en Espagne pour élaborer ce type de produit…
Des questions réglementaires
Du côté de la Confédération des appellations et vins de Bourgogne (CAVB), son président, Jean-Michel Aubinel, par ailleurs vice-président de la Cnaoc, y voit une faille dans la réglementation viticole française. « C’est en effet un sujet délicat que ce développement de VSIG à proximité immédiate d’aires d’appellations d’origine contrôlée (AOC) », ajoute Jean-Michel Aubinel.
De fait, ce débat est sur la table depuis la libéralisation des droits de plantation devenus autorisations de plantation au 1er janvier 2016. La CAVB a certes essayé de créer une place aux représentants des VSIG au sein même de ses instances, lesquels représentants sont - pour le moment - uniquement organisés en Syndicat au niveau national. « Nous n’arrivons pas à savoir s’il existe un échelon régional », déplore le président de la CAVB.
Des idées pour d’autres
La véritable crainte de ce dernier serait de voir fleurir des parcelles de VSIG, dans parcelles à proximité, à côté ou même au milieu des zones délimitées des appellations de Bourgogne. « Avec du marketing et une bonne communication, il est facile d’induire les consommateurs non avertis en erreur, puisque ce seront des vins issus de vignes réellement plantées en Bourgogne au sens de la région administrative », reconnaît-il. « Le risque porte sur le détournement de notoriété des appellations », souligne le représentant des ODG d’appellations de Bourgogne.
Ce projet pourrait « donner des idées à d’autres opérateurs », même si ils n’en n’avaient pas réellement besoin. En effet, l’ensemble de la « chaîne » vitivinicole nécessaire est déjà présente et organisée en Bourgogne : matériels, sites, logistiques… Ce qui la rend compétitive ! « C’est plus simple de s’implanter ici que dans des zones éloignées ou isolées », analyse de fait Jean-Michel Aubinel. Les négociants ou les grands groupes vinicoles (Castel, Les Grands chais de France…) ayant tous envie de rapprocher la production de raisins de leurs sites de vinification. Déjà équipés, les vignerons ayant des parcelles situées dans des zones non AOC pourraient, eux aussi, être intéressés.
Le véritable problème réside dans l’organisation des contrôles adéquats qui s’en suivront. La charte des Vins de France interdit de fait déjà certaines mentions, tels que "Mis en bouteille à la propriété" ou "Mis en bouteille en région de production" qui sont des mentions réservées aux seules AOP et aux IGP.
De futurs contingents VSIG ?
Appelé à donner un avis sur ces autorisations de plantation et ainsi de définir la politique de vins de France dans notre région de production majoritairement AOP, le conseil de Bassin du 23 octobre devrait débattre - et pour la première fois - de l’opportunité ou non de mettre des « contingents futurs » sur les VSIG. La famille viticole et le négoce seront ainsi appelés à se positionner, mais seule l’administration aura le mot de la fin.
Ce projet –qui ne doit en aucun cas opposer les uns aux autres– se pose comme un cas concret de la nécessité d’une gestion territoriale collective au sujet de laquelle un consensus est attendu. Plus spécifiquement, il pose aussi la question de la gestion stratégique des autorisations de plantation alors que sa gouvernance par les seules ODG est toujours remise en cause par la famille Négoce qui réclame une co-gestion interprofessionnelle. Le refus de la famille viticole a, jusqu’à présent, été sans appel. La CAVB rétorquant qu’il s’agit de ses prérogatives.
Des questions réglementaires en suspens suite à l'expérimentation de "Vins de France" en Bresse

En 2016, la France a importé un nouveau record de 7,5 millions d’hectolitres (Mhl) de vins étrangers dont 6,15 millions en vrac, principalement venus d’Espagne (5,5 Mhl ; 248 millions d’€). De nombreux acteurs –Négoces ou Caves coopératives– conditionnent d’ailleurs en Bourgogne ces vins sans indication géographique (VSIG). Le groupe Boisset à Nuits-Saint-Georges (Côte d’or) en fait partie.
Pour beaucoup, ce "trou" des VSIG dans la balance commerciale française apparaît comme une fatalité, la compétitivité nationale étant accusée d’être immanquablement battue par d’autres pays. Et si ce n’était pas vrai ? Et si il était possible d’inverser les choses ? Certains y croient. Boisset en tête. Le négociant s’est donc naturellement rapproché d’un acteur local capable de répondre à cette double problématique : économique et technique.
Une expérimentation
La coopérative Bourgogne du Sud a répondu par la positive pour tester la faisabilité d’un tel projet. Elle a le savoir-faire et les infrastructures pour produire ces raisins régis par le cahier des charges des vins de France.
Du côté de la Draaf Bourgogne Franche-Comté et de FranceAgriMer à Dijon, des demandes d’autorisation de plantation pour des VSIG ont été réalisées dans des proportions « plus conséquentes » que les années passées. 89 hectares (ha) sur l’ensemble du bassin Bourgogne-Beaujolais-Jura-Savoie. 65 ha ont été autorisés en vue de plantations en plaine de Saône lors de cette campagne 2017/2018. Une quinzaine d’exploitations se lanceraient ainsi dans la culture de la vigne autour de Pierre de Bresse ou encore à Saint-Loup-Géanges. L’expérimentation prévoit onze cépages différents, dont le chardonnay, le colombard, l’ugni blanc…
Cette expérimentation soulève toutefois des questions à la profession viticole. Elle soulève également des inquiétudes au sein de la famille bourguignonne du négoce, révélée au grand jour lors de la conférence de presse du BIVB (lire notre édition du 29 septembre en page 12).
La Fédération des caves coopératives, par la voie de son président, Marc Sangoy, se dit « inquiet » par cette « expérimentation qui, si elle s’avère positive, pourrait aller jusqu’à 180 ha de vignes, dont 30 ha de chardonnay ». Il s’agit évidemment de vignes à « faible densité » mais aux potentiels de rendements « impressionnants ». Les exploitants visant entre 120 à 140 hl/ha, selon les cépages. Un objectif techniquement possible avec la ferti-irrigation. La production serait ensuite destinée à la confection de vins mousseux par la Maison Boisset. Il est à noter que le négociant nuiton s’approvisionne pour l’heure d'autres bassins de production ou en Espagne pour élaborer ce type de produit…
Des questions réglementaires
Du côté de la Confédération des appellations et vins de Bourgogne (CAVB), son président, Jean-Michel Aubinel, par ailleurs vice-président de la Cnaoc, y voit une faille dans la réglementation viticole française. « C’est en effet un sujet délicat que ce développement de VSIG à proximité immédiate d’aires d’appellations d’origine contrôlée (AOC) », ajoute Jean-Michel Aubinel.
De fait, ce débat est sur la table depuis la libéralisation des droits de plantation devenus autorisations de plantation au 1er janvier 2016. La CAVB a certes essayé de créer une place aux représentants des VSIG au sein même de ses instances, lesquels représentants sont - pour le moment - uniquement organisés en Syndicat au niveau national. « Nous n’arrivons pas à savoir s’il existe un échelon régional », déplore le président de la CAVB.
Des idées pour d’autres
La véritable crainte de ce dernier serait de voir fleurir des parcelles de VSIG, dans parcelles à proximité, à côté ou même au milieu des zones délimitées des appellations de Bourgogne. « Avec du marketing et une bonne communication, il est facile d’induire les consommateurs non avertis en erreur, puisque ce seront des vins issus de vignes réellement plantées en Bourgogne au sens de la région administrative », reconnaît-il. « Le risque porte sur le détournement de notoriété des appellations », souligne le représentant des ODG d’appellations de Bourgogne.
Ce projet pourrait « donner des idées à d’autres opérateurs », même si ils n’en n’avaient pas réellement besoin. En effet, l’ensemble de la « chaîne » vitivinicole nécessaire est déjà présente et organisée en Bourgogne : matériels, sites, logistiques… Ce qui la rend compétitive ! « C’est plus simple de s’implanter ici que dans des zones éloignées ou isolées », analyse de fait Jean-Michel Aubinel. Les négociants ou les grands groupes vinicoles (Castel, Les Grands chais de France…) ayant tous envie de rapprocher la production de raisins de leurs sites de vinification. Déjà équipés, les vignerons ayant des parcelles situées dans des zones non AOC pourraient, eux aussi, être intéressés.
Le véritable problème réside dans l’organisation des contrôles adéquats qui s’en suivront. La charte des Vins de France interdit de fait déjà certaines mentions, tels que "Mis en bouteille à la propriété" ou "Mis en bouteille en région de production" qui sont des mentions réservées aux seules AOP et aux IGP.
De futurs contingents VSIG ?
Appelé à donner un avis sur ces autorisations de plantation et ainsi de définir la politique de vins de France dans notre région de production majoritairement AOP, le conseil de Bassin du 23 octobre devrait débattre - et pour la première fois - de l’opportunité ou non de mettre des « contingents futurs » sur les VSIG. La famille viticole et le négoce seront ainsi appelés à se positionner, mais seule l’administration aura le mot de la fin.
Ce projet –qui ne doit en aucun cas opposer les uns aux autres– se pose comme un cas concret de la nécessité d’une gestion territoriale collective au sujet de laquelle un consensus est attendu. Plus spécifiquement, il pose aussi la question de la gestion stratégique des autorisations de plantation alors que sa gouvernance par les seules ODG est toujours remise en cause par la famille Négoce qui réclame une co-gestion interprofessionnelle. Le refus de la famille viticole a, jusqu’à présent, été sans appel. La CAVB rétorquant qu’il s’agit de ses prérogatives.




