L’interdiction du glyphosate, un problème économique avant tout
L’interdiction du glyphosate d’ici trois ans, promue par le gouvernement, est possible à condition de trouver des méthodes alternatives à un coût raisonnable d’ici là. Une gageure pour les intervenants d’une table ronde sur le sujet, organisée le 23 mars par l’Association française des journalistes agricoles (AFJA) et l’Association des journalistes de l’environnement (AJE).
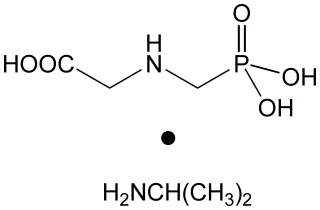
« La question du glyphosate n’est pas de savoir s’il y a des alternatives mais si on peut les faire passer économiquement ! », s’est exclamé Xavier Reboud, directeur de recherche à l’Inra, le 23 mars lors d’un débat organisé par l’Association française des journalistes agricoles (AFJA) et l’Association des journalistes de l’environnement (AJE). En effet, les alternatives au glyphosate existent mais elles sont économiquement plus coûteuses. « Il n’y a pas de solution plus économique », explique Xavier Reboud qui donne le chiffre de 30 €/ha pour se débarrasser de toutes les adventices. Il cite en exemple l’arrêt du glyphosate en vigne : « Cela représente une personne pour 20 ha, sur quatre mois, soit un surcoût de 0,23 € par bouteille et 5 €/hl. Face aux Espagnols ou aux Italiens, le producteur perd son marché. Ce que nous disent les agriculteurs, c’est qu’ils ont peur d’avoir à faire à une concurrence déloyale avec les autres pays d’Europe, au travers de cet arrêt du glyphosate d’ici trois ans. Et cela d’autant plus que cette concurrence existe déjà ! »
À entendre Benoît Lavier, président de l’Association pour la promotion d’une agriculture durable (Apad) ou Roger Genet, directeur de l’Anses, les agriculteurs auront à changer leurs pratiques et parfois même à revoir leur système de production (évolution des rotations, etc.). Cela prendra plusieurs années avant de retrouver un niveau de compétitivité équivalent à celui d’aujourd’hui.
Une possible perte de compétitivité
Roger Genet a également donné quelques chiffres évocateurs : « En France, 9 000 tonnes de glyphosate sont utilisées dont 7 000 tonnes sont attribuées à un usage agricole. En Argentine, c’est 300 000 tonnes ». Il estime que toute la difficulté réside dans le peu de molécules chimiques ayant les mêmes propriétés que le glyphosate. « Les volumes des ventes de phytosanitaires augmentent et en parallèle, la diversité des molécules chimiques diminue. Cela ne peut que provoquer l’apparition de résistance. Entre 2008, 425 molécules étaient autorisées. Aujourd’hui, ce sont 352 dont 75 utilisés en biocontrôle », souligne-t-il. Les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits utilisés dans le biocontrôle sont moins coûteuses (2 000 € contre 4 000 € pour une molécule issue de l’industrie) mais plus longues à obtenir. « Il est très difficile d’évaluer l’efficacité des méthodes de biocontrôle », à l’inverse des produits chimiques issus d’entreprises dont « les études toxicologiques sont très poussées », observe le directeur de l’Anses.
Une remise en cause du modèle agricole
Le directeur de l’Anses reconnaît préférer des études issues du milieu industriel que celles issues de revues de publications scientifiques à comité de lecture, « dont le protocole expérimental n’est pas forcément parfait ». « Il ne serait pas acceptable de sortir du glyphosate pour le remplacer par un autre herbicide plus dangereux », relève de son côté Benoît Lavier. Au final, « la décision est éminemment politique et non scientifique », constate Xavier Reboud. L’interdiction du glyphosate revient à poser la question du modèle agricole et de la valorisation des produits. « Le plus inquiet de vous tous, c’est probablement moi ! », précise Benoît Lavier avant d’ajouter : « Le plus important, pour moi, c’est de s’entendre sur le modèle agricole que nous voulons ».
En attendant, l’ensemble des intervenants, dont Denis Longevialle, secrétaire général de l’association de promotion des méthodes de biocontrôle (IBMA), ont fait remarquer que la recherche de solutions de biocontrôle, alternatives aux produits phytosanitaires, nécessite des moyens conséquents.




