La charte régionale des "bonnes pratiques" viticoles, c'est avant tout de bonnes pratiques à (s’)appliquer
La CAVB, le BIVB et les chambres d’Agriculture ont récemment organisé des réunions d’information en direction des vignerons pour présenter en détail la Charte régionale des "bonnes pratiques" viticoles. Elle constitue peut-être la dernière "chance" pour la profession de ne pas subir des lois plus contraignantes.
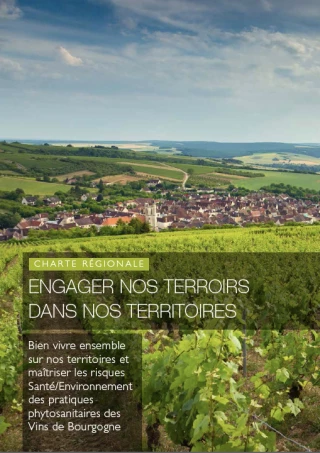
La Charte régionale des "bonnes pratiques" viticoles va plus loin que les seules pratiques viticoles, elle qui se nomme en réalité "Engager nos terroirs dans nos territoires". Elle vise le « bien vivre ensemble sur nos territoires » et propose de « maîtriser les risques Santé/Environnement des pratiques phytosanitaires des vins de Bourgogne ». En juillet, l’interprofession (BIVB) a envoyé le fascicule à tous les producteurs en Bourgogne.
Membre du groupe qui a travaillé durant plus d’un an à la CAVB et au BIVB pour la rédiger, Jérôme Chevalier explique « qu’elle n’est pas figée. Les vignerons peuvent donner leur avis ». D’où l’organisation de réunions de Chablis à La Chapelle-de-Guinchay en fin d’année 2017 et en ce début 2018, en présence d'un grand nombre de professionnels. A ceux qui n’ont pu venir, le président de l’Union des producteurs de vins Mâcon met en garde : « on est attendu par les élus, par les médias, par les associations… et ils ne vont pas nous rater s’il n’y a pas de résultats ».
Au niveau de la Saône-et-Loire, pour l’heure la Charte départementale - réalisée cette fois sous l’égide de l’Union viticole 71 et de la FDSEA 71 - reste en vigueur avec « les bonnes pratiques » à proximité des écoles notamment. Une charte qui a convaincu jusqu’à présent la préfecture de ne pas prendre d’arrêté, ce qui aurait alors signifié davantage de contrôles et de possibles sanctions. En effet, les services de l’Etat sont conscients de la réalité des efforts réalisés par les vignerons du département.
Pas d’effet d’annonce
La charte régionale vise aussi cet objectif mais, avec l’appui du BIVB, elle se veut également un « document de communication externe ». En somme, il ne s’agit pas « d’une charte phyto » et va bien au-delà. Son véritable objectif est plutôt de permettre aux vignerons « de bien vivre ensemble » avec le reste de la société. Un vœu pieu certes quand on connaît certains opposants mais qui doit permettre à tout vigneron « d’expliquer le métier à ceux qui n’y connaissent rien ». Pas question par contre de faire du "greenwashing". « Il nous faut être plus nickel en interne (professionnels) avant de communiquer », insiste Jérôme Chevalier qui ne veut pas vivre un retour de baton.
Cette Charte régionale comprend donc quatre grands "volets" : la modernisation des matériels de pulvérisation, la protection de la santé de tous, le bien vivre ensemble et les contraintes du métier. « La partie économique a été prise en compte pour conserver la rentabilité », précise Marion Sauquëre. La profession espère obtenir des aides pour s’équiper de pulvérisateurs plus performants et qui limitent la dérive. Mais également des soutiens sur la formation des élèves ou apprentis, des vignerons, des salariés et des constructeurs pour améliorer le réglage du matériel.
Abandon des canons
La Charte donne un « plan d’actions avec un calendrier précis ». La mesure des résultats sera fait par les chambres d’Agriculture pour tout ce qui est adaptation du parc matériel, abandon à terme de l’usage des canons… L’engagement est pris pour 2025. « L’idée est de ne pas laisser seul le moindre vigneron, en évaluant si besoin la faisabilité technique et économique ». La profession viticole met également gentiment la pression sur les constructeurs de pulvés. En effet, le ministère a édité une liste de matériels homologués. Sauf que « beaucoup de pulvés vendus ne le sont pas ! En cas de contrôle, c'est alors le viticulteur seul qui risque d’être pénalisé et aucunement les constructeurs ». En Saône-et-Loire, des rencontres à venir avec l’ensemble des distributeurs doivent permettre de les associer. Idem avec les marchands de produits phytosanitaires. « Ils bougent et mettent en place des services. Ce sont eux qui font les programmes. Il faut y travailler avec eux », positive Jérôme Chevalier.
Gérer ravageurs et résistances
La sortie des herbicides d’automne et d’hiver se profile assez sûrement. Par contre, encore faut-il évaluer la toxicité de nouveaux produits, le cout technico-économique d’itinéraires alternatifs et concevoir plusieurs programmes contre certaines maladies. Des essais vont d’ailleurs se tenir sans aucun CMR (Cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques). Dans un programme conventionnel classique, les produits classés CMR représentent environ 25 % des anti-oïdum et anti-mildiou, estime la chambre d’Agriculture, « surtout en encadrement de fleurs », précise Benjamin Alban, du service Vigne & Vin. « C’est possible. On va, avec les conseillers de négoce et de coop, proposer des programmes sans CMR. Reste après à gérer le black rot en début de campagne et la montée des résistances aux produits sur plusieurs années », nuançait-il tout de suite. Autre « limite » attendue, la lutte contre certaines cochenilles ou cicadelles… notamment celle transmettant la flavescence dorée.
Remplacer par d’autres produits
De fait, si certains produits sont retirés des programmes, cela n’enlève pas la pression cryptogamiques, celle des ravageurs ou même le dépérissement des bois. « L’idée, c’est de les remplacer par d’autres en utilisant des produits de bio-contrôles, dits naturels, pour essayer de compenser », a bon espoir Benjamin Alban.
La chambre d’Agriculture va surtout produire des documents "techniques" à destination du grand public « pour relayer aux non viticulteurs des communes viticoles pour qu’ils comprennent pourquoi vous traitez ou ne traitez pas ». Ce travail de vulgarisation n’a jamais été tenté jusqu’à présent. Pas question néanmoins de ne se focaliser que sur les seuls traitements. « Il est important de redire que la viticulture est principalement un travail manuel avec 350 heures/ha/an ». Et d'insister sur le fait que le travail avec du matériel « ne veut pas forcément dire traitement », mais bien plus souvent travail du sol, rognage, récolte… à hauteur de près de 35 heures/ha/an.
Se mettre à la place de l’autre
Evidemment, la partie traitement par les phytos ne peut être occultée. « Il nous faut expliquer les maladies. Déjà que pour nous parfois, on a du mal alors eux, ça les dépasse », rappelle Benjamin Alban. Les vignerons sont donc invités à être pédagogues. Rappeler comment oïdium, mildiou, black rot… sont arrivées en France et illustrer que sans traitement, potentiellement pas de récolte.
L’analogie avec les médicaments peut marcher. « La protection se fait sur 100 jours et vos médicaments ne sont malheureusement efficaces que sur une durée de 8 à 10 jours. Voici pourquoi vous passez huit à dix fois », est une phrase type. Le niveau d’après arrive avec les ravageurs. La lutte raisonnée ne se fait qu’après dépassement d’un certain seuil de présence. Enfin, dernier niveau avec les maladies du bois qui menacent carrément la vigne entière.
Pour finir, « demandez leur ce qu’ils feraient à votre place ? En règle général, la connaissance fait changer d’avis », positivent les vignerons qui ont déjà fait des réunions communales sur le sujet. « Les gens veulent surtout savoir ce que vous épandez. Un texto pour les informer avant un traitement peut éviter bien des problèmes de voisinage ». Cela nécessite certes un peu d’organisation, mais le jeu en vaut la chandelle.
La charte régionale des "bonnes pratiques" viticoles, c'est avant tout de bonnes pratiques à (s’)appliquer
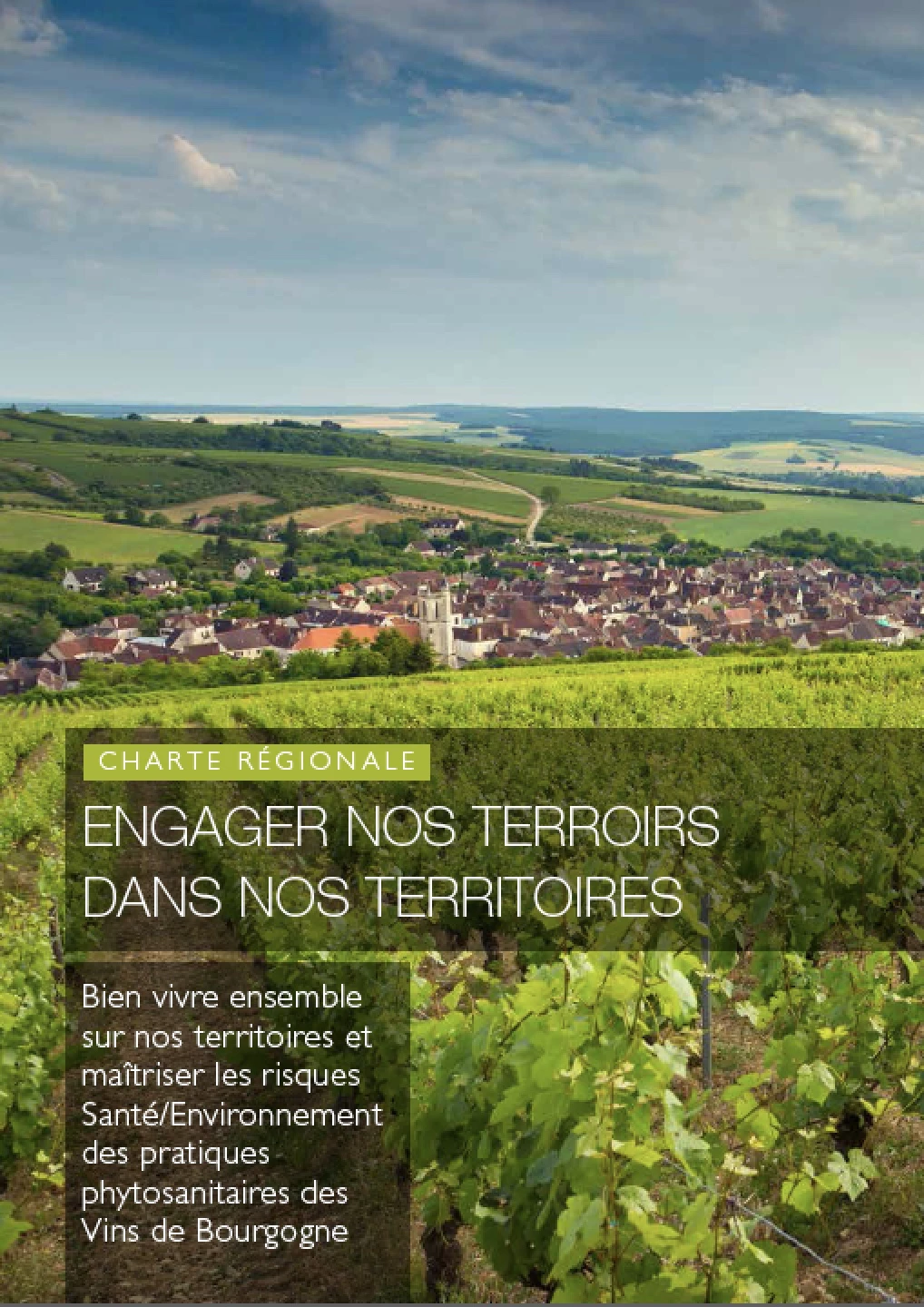
La Charte régionale des "bonnes pratiques" viticoles va plus loin que les seules pratiques viticoles, elle qui se nomme en réalité "Engager nos terroirs dans nos territoires". Elle vise le « bien vivre ensemble sur nos territoires » et propose de « maîtriser les risques Santé/Environnement des pratiques phytosanitaires des vins de Bourgogne ». En juillet, l’interprofession (BIVB) a envoyé le fascicule à tous les producteurs en Bourgogne.
Membre du groupe qui a travaillé durant plus d’un an à la CAVB et au BIVB pour la rédiger, Jérôme Chevalier explique « qu’elle n’est pas figée. Les vignerons peuvent donner leur avis ». D’où l’organisation de réunions de Chablis à La Chapelle-de-Guinchay en fin d’année 2017 et en ce début 2018, en présence d'un grand nombre de professionnels. A ceux qui n’ont pu venir, le président de l’Union des producteurs de vins Mâcon met en garde : « on est attendu par les élus, par les médias, par les associations… et ils ne vont pas nous rater s’il n’y a pas de résultats ».
Au niveau de la Saône-et-Loire, pour l’heure la Charte départementale - réalisée cette fois sous l’égide de l’Union viticole 71 et de la FDSEA 71 - reste en vigueur avec « les bonnes pratiques » à proximité des écoles notamment. Une charte qui a convaincu jusqu’à présent la préfecture de ne pas prendre d’arrêté, ce qui aurait alors signifié davantage de contrôles et de possibles sanctions. En effet, les services de l’Etat sont conscients de la réalité des efforts réalisés par les vignerons du département.
Pas d’effet d’annonce
La charte régionale vise aussi cet objectif mais, avec l’appui du BIVB, elle se veut également un « document de communication externe ». En somme, il ne s’agit pas « d’une charte phyto » et va bien au-delà. Son véritable objectif est plutôt de permettre aux vignerons « de bien vivre ensemble » avec le reste de la société. Un vœu pieu certes quand on connaît certains opposants mais qui doit permettre à tout vigneron « d’expliquer le métier à ceux qui n’y connaissent rien ». Pas question par contre de faire du "greenwashing". « Il nous faut être plus nickel en interne (professionnels) avant de communiquer », insiste Jérôme Chevalier qui ne veut pas vivre un retour de baton.
Cette Charte régionale comprend donc quatre grands "volets" : la modernisation des matériels de pulvérisation, la protection de la santé de tous, le bien vivre ensemble et les contraintes du métier. « La partie économique a été prise en compte pour conserver la rentabilité », précise Marion Sauquëre. La profession espère obtenir des aides pour s’équiper de pulvérisateurs plus performants et qui limitent la dérive. Mais également des soutiens sur la formation des élèves ou apprentis, des vignerons, des salariés et des constructeurs pour améliorer le réglage du matériel.
Abandon des canons
La Charte donne un « plan d’actions avec un calendrier précis ». La mesure des résultats sera fait par les chambres d’Agriculture pour tout ce qui est adaptation du parc matériel, abandon à terme de l’usage des canons… L’engagement est pris pour 2025. « L’idée est de ne pas laisser seul le moindre vigneron, en évaluant si besoin la faisabilité technique et économique ». La profession viticole met également gentiment la pression sur les constructeurs de pulvés. En effet, le ministère a édité une liste de matériels homologués. Sauf que « beaucoup de pulvés vendus ne le sont pas ! En cas de contrôle, c'est alors le viticulteur seul qui risque d’être pénalisé et aucunement les constructeurs ». En Saône-et-Loire, des rencontres à venir avec l’ensemble des distributeurs doivent permettre de les associer. Idem avec les marchands de produits phytosanitaires. « Ils bougent et mettent en place des services. Ce sont eux qui font les programmes. Il faut y travailler avec eux », positive Jérôme Chevalier.
Gérer ravageurs et résistances
La sortie des herbicides d’automne et d’hiver se profile assez sûrement. Par contre, encore faut-il évaluer la toxicité de nouveaux produits, le cout technico-économique d’itinéraires alternatifs et concevoir plusieurs programmes contre certaines maladies. Des essais vont d’ailleurs se tenir sans aucun CMR (Cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques). Dans un programme conventionnel classique, les produits classés CMR représentent environ 25 % des anti-oïdum et anti-mildiou, estime la chambre d’Agriculture, « surtout en encadrement de fleurs », précise Benjamin Alban, du service Vigne & Vin. « C’est possible. On va, avec les conseillers de négoce et de coop, proposer des programmes sans CMR. Reste après à gérer le black rot en début de campagne et la montée des résistances aux produits sur plusieurs années », nuançait-il tout de suite. Autre « limite » attendue, la lutte contre certaines cochenilles ou cicadelles… notamment celle transmettant la flavescence dorée.
Remplacer par d’autres produits
De fait, si certains produits sont retirés des programmes, cela n’enlève pas la pression cryptogamiques, celle des ravageurs ou même le dépérissement des bois. « L’idée, c’est de les remplacer par d’autres en utilisant des produits de bio-contrôles, dits naturels, pour essayer de compenser », a bon espoir Benjamin Alban.
La chambre d’Agriculture va surtout produire des documents "techniques" à destination du grand public « pour relayer aux non viticulteurs des communes viticoles pour qu’ils comprennent pourquoi vous traitez ou ne traitez pas ». Ce travail de vulgarisation n’a jamais été tenté jusqu’à présent. Pas question néanmoins de ne se focaliser que sur les seuls traitements. « Il est important de redire que la viticulture est principalement un travail manuel avec 350 heures/ha/an ». Et d'insister sur le fait que le travail avec du matériel « ne veut pas forcément dire traitement », mais bien plus souvent travail du sol, rognage, récolte… à hauteur de près de 35 heures/ha/an.
Se mettre à la place de l’autre
Evidemment, la partie traitement par les phytos ne peut être occultée. « Il nous faut expliquer les maladies. Déjà que pour nous parfois, on a du mal alors eux, ça les dépasse », rappelle Benjamin Alban. Les vignerons sont donc invités à être pédagogues. Rappeler comment oïdium, mildiou, black rot… sont arrivées en France et illustrer que sans traitement, potentiellement pas de récolte.
L’analogie avec les médicaments peut marcher. « La protection se fait sur 100 jours et vos médicaments ne sont malheureusement efficaces que sur une durée de 8 à 10 jours. Voici pourquoi vous passez huit à dix fois », est une phrase type. Le niveau d’après arrive avec les ravageurs. La lutte raisonnée ne se fait qu’après dépassement d’un certain seuil de présence. Enfin, dernier niveau avec les maladies du bois qui menacent carrément la vigne entière.
Pour finir, « demandez leur ce qu’ils feraient à votre place ? En règle général, la connaissance fait changer d’avis », positivent les vignerons qui ont déjà fait des réunions communales sur le sujet. « Les gens veulent surtout savoir ce que vous épandez. Un texto pour les informer avant un traitement peut éviter bien des problèmes de voisinage ». Cela nécessite certes un peu d’organisation, mais le jeu en vaut la chandelle.




