Les contrats avec indices de coût de production, une demande pressante des syndicats
Si le débat s’est focalisé autour du seuil de revente à perte, les syndicats agricoles rappellent que ce dispositif ne sera pas suffisant pour que les agriculteurs retrouvent suffisamment de valeur dans leurs produits. Pour eux, cela passera par la contractualisation, à condition d’intégrer les coûts de production des agriculteurs dans la construction du prix. Toute la question est de savoir si cette mesure sera retenue par Emmanuel Macron.
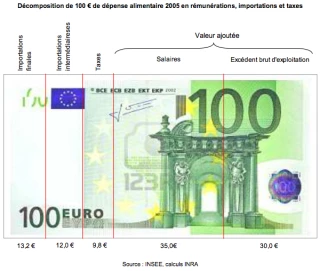
« Il est très clair qu’avec une ou deux mesures acceptées sur les sept que nous préconisons, nous n’arriverons pas à redonner de la valeur au producteur. Nous demandons bien un panel de mesures », insistait Patrick Bénézit, secrétaire général adjoint de la FNSEA, le 4 octobre. D’où l’importance de travailler sur la contractualisation et la création d’indicateurs de coûts de production, afin d’inverser la construction du prix.
Les syndicats agricoles sont unanimes à ce sujet : si la contractualisation et l’intégration des coûts de production dans la construction du prix ne sont pas prises en compte par le gouvernement, les autres mesures (seuil de revente à perte – SRP – et encadrement des promotions) auront des effets insuffisants pour les producteurs.
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, a rappelé d’ailleurs la nécessaire « marche en avant de la construction du prix », avec une offre de prix effectuée par le producteur et non un prix subi après prélèvement de la marge des industriels et des distributeurs. Jérémy Decerle, président des JA, insiste sur le fait que « le débat » des EGA, même s’il a été dominant la semaine passée, « ne se résume pas au seuil de revente à perte ».
Introduction d’une formule de prix
Dans le document « livrable » au gouvernement issu des ateliers 5, 6 et 7 des États généraux de l’alimentation portant sur de la contractualisation (voir Agra Presse n°3612 du 2 octobre), les présidents d’ateliers proposent un contrat avec « introduction d’une formule de prix » qui « doit reposer sur des indicateurs relatifs aux coûts de production ou aux marges, et des indicateurs relatifs aux différentes valorisations des marchés ». Toute la question est de savoir comment intégrer ces références dans les contrats.
Du côté de Coop de France, concernant la contractualisation, Michel Prugue, président de Coop de France, évoquait, le 4 octobre, « un discours idéologique » des producteurs, plein de « bonnes intentions ». « Le coût de production dans le contrat, le consommateur ne l’acceptera pas », continuait-il. Il préfère parler d’outils de gestion de crise ou de compétitivité des exploitations, dans un marché mondialisé.
Une loi Sapin 2 « pas assez contraignante »
La loi Sapin 2, votée en 2016, avait déjà rendu obligatoire la référence à des indicateurs de prix dans les contrats entre industriels et distributeurs (art.94) dans la filière laitière. Les critères et modalités de détermination du prix, sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, devaient donc faire référence « à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. ». Cet indicateur de référence permettait d’activer ou non la clause de renégociation. Pour l’heure, selon bon nombre de professionnels, la loi Sapin 2 ne fonctionne pas. « Elle n’est pas allée assez loin », soulignait à ce sujet Christiane Lambert. « Pas assez contraignante », relevait Temanuata Girard, secrétaire générale de la Conf’.
Le gouvernement pourrait donc soit s’en remettre aux interprofessions pour qu’elles se chargent de définir les indicateurs pertinents à mettre dans les contrats, soit utiliser la voie législative en renforçant la loi Sapin 2.
Rien sur l’inversion du sens des négociations dans le bilan de l’atelier 7
La crainte de certains, connaissant les éternelles dissensions entre les différents maillons des filières, est bien de voir la problématique renvoyée aux interprofessions, sans arbitrage de la part de l’État. André Bonnard, secrétaire général de la FNPL est d’ailleurs sans appel à ce sujet : « SRP et promo, sans retour de valeur au producteur, c’est non ! Le deal doit être global, sinon l’accord sera déséquilibré », s’est-il exclamé le 5 octobre. Il a évoqué des pages entières du bilan de l’atelier 7 consacrées au SRP et à l’encadrement des promotions mais « rien » sur « l’inversion du sens des négociations ». Prise en compte des coûts de production et du marché intérieur dans les contrats au sein de la filière sont, pour lui, « oubliés ». « J’ai l’impression qu’au final les producteurs seront les délaissés de ces États généraux de l’alimentation », a-t-il observé. André Bonnard a revendiqué également un arbitrage si jamais le sujet était renvoyé aux interprofessions.
Dans tous les cas, si Christiane Lambert évoque une action d’Emmanuel Macron par « loi et ordonnances » et leur difficile application lors des prochaines négociations commerciales à marque nationale, tout le monde est en attente du discours du président de la République le 11 octobre. En attendant, la FNSEA annonce déjà un rassemblement de plusieurs heures, place de la République à Paris ce jour-là. Et la Conf’prévoit, elle aussi, une possible action le même jour.
Les contrats avec indices de coût de production, une demande pressante des syndicats

« Il est très clair qu’avec une ou deux mesures acceptées sur les sept que nous préconisons, nous n’arriverons pas à redonner de la valeur au producteur. Nous demandons bien un panel de mesures », insistait Patrick Bénézit, secrétaire général adjoint de la FNSEA, le 4 octobre. D’où l’importance de travailler sur la contractualisation et la création d’indicateurs de coûts de production, afin d’inverser la construction du prix.
Les syndicats agricoles sont unanimes à ce sujet : si la contractualisation et l’intégration des coûts de production dans la construction du prix ne sont pas prises en compte par le gouvernement, les autres mesures (seuil de revente à perte – SRP – et encadrement des promotions) auront des effets insuffisants pour les producteurs.
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, a rappelé d’ailleurs la nécessaire « marche en avant de la construction du prix », avec une offre de prix effectuée par le producteur et non un prix subi après prélèvement de la marge des industriels et des distributeurs. Jérémy Decerle, président des JA, insiste sur le fait que « le débat » des EGA, même s’il a été dominant la semaine passée, « ne se résume pas au seuil de revente à perte ».
Introduction d’une formule de prix
Dans le document « livrable » au gouvernement issu des ateliers 5, 6 et 7 des États généraux de l’alimentation portant sur de la contractualisation (voir Agra Presse n°3612 du 2 octobre), les présidents d’ateliers proposent un contrat avec « introduction d’une formule de prix » qui « doit reposer sur des indicateurs relatifs aux coûts de production ou aux marges, et des indicateurs relatifs aux différentes valorisations des marchés ». Toute la question est de savoir comment intégrer ces références dans les contrats.
Du côté de Coop de France, concernant la contractualisation, Michel Prugue, président de Coop de France, évoquait, le 4 octobre, « un discours idéologique » des producteurs, plein de « bonnes intentions ». « Le coût de production dans le contrat, le consommateur ne l’acceptera pas », continuait-il. Il préfère parler d’outils de gestion de crise ou de compétitivité des exploitations, dans un marché mondialisé.
Une loi Sapin 2 « pas assez contraignante »
La loi Sapin 2, votée en 2016, avait déjà rendu obligatoire la référence à des indicateurs de prix dans les contrats entre industriels et distributeurs (art.94) dans la filière laitière. Les critères et modalités de détermination du prix, sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, devaient donc faire référence « à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. ». Cet indicateur de référence permettait d’activer ou non la clause de renégociation. Pour l’heure, selon bon nombre de professionnels, la loi Sapin 2 ne fonctionne pas. « Elle n’est pas allée assez loin », soulignait à ce sujet Christiane Lambert. « Pas assez contraignante », relevait Temanuata Girard, secrétaire générale de la Conf’.
Le gouvernement pourrait donc soit s’en remettre aux interprofessions pour qu’elles se chargent de définir les indicateurs pertinents à mettre dans les contrats, soit utiliser la voie législative en renforçant la loi Sapin 2.
Rien sur l’inversion du sens des négociations dans le bilan de l’atelier 7
La crainte de certains, connaissant les éternelles dissensions entre les différents maillons des filières, est bien de voir la problématique renvoyée aux interprofessions, sans arbitrage de la part de l’État. André Bonnard, secrétaire général de la FNPL est d’ailleurs sans appel à ce sujet : « SRP et promo, sans retour de valeur au producteur, c’est non ! Le deal doit être global, sinon l’accord sera déséquilibré », s’est-il exclamé le 5 octobre. Il a évoqué des pages entières du bilan de l’atelier 7 consacrées au SRP et à l’encadrement des promotions mais « rien » sur « l’inversion du sens des négociations ». Prise en compte des coûts de production et du marché intérieur dans les contrats au sein de la filière sont, pour lui, « oubliés ». « J’ai l’impression qu’au final les producteurs seront les délaissés de ces États généraux de l’alimentation », a-t-il observé. André Bonnard a revendiqué également un arbitrage si jamais le sujet était renvoyé aux interprofessions.
Dans tous les cas, si Christiane Lambert évoque une action d’Emmanuel Macron par « loi et ordonnances » et leur difficile application lors des prochaines négociations commerciales à marque nationale, tout le monde est en attente du discours du président de la République le 11 octobre. En attendant, la FNSEA annonce déjà un rassemblement de plusieurs heures, place de la République à Paris ce jour-là. Et la Conf’prévoit, elle aussi, une possible action le même jour.



