Pour Guillaume Mateuil, « le métier a encore de l’avenir ! »
Il y a bientôt vingt ans, Guillaume Mateuil avait choisi de s’associer avec ses parents avec seulement 70 charolaises. Depuis, l'éleveur a toujours fait en sorte d’assurer son revenu par la valeur ajoutée et la réduction des charges. Et ça marche !
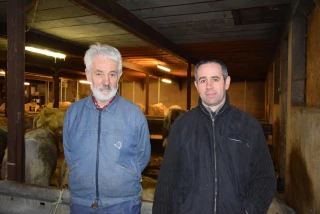
Guillaume Mateuil s’est installé en 1999 sur la ferme familiale d’Oudry. Une installation atypique car le jeune éleveur ne voulait pas agrandir la structure de ses parents. En rejoignant son père dans un Gaec, son projet était de conserver la structure existante. Aller chercher de la valeur ajoutée plutôt que développer la production, explique-t-il. Et c’est en convertissant l’élevage dans l’agriculture biologique que Guillaume projetait de gagner une plus value de +0,30 à 0,46 € par kilo de viande produit. De quoi supporter son installation avait-il calculé.
Ce choix audacieux « revenait à refuser la transparence économique et l’ajout d’une SMI ainsi que faire l’impasse sur les primes supplémentaires », explique-t-il. Refusé en CDOA, son dossier a alors dû être défendu au ministère avec le soutien du syndicalisme. « Cela s’est pourtant avéré viable », révèle aujourd’hui Guillaume.
En 2006, année du départ en retraite de ses parents, le jeune éleveur a pu reprendre l’ensemble du capital de la ferme qui était moins important que si elle avait été agrandie.
Depuis 1999, l’exploitation de la famille Mateuil a toujours possédé un cheptel charolais de 70 à 75 vêlages. La surface s’est légèrement restructurée passant de 114 à 123 hectares. Pour Guillaume, « pour bien faire son travail, il faut se limiter. L’agrandissement se fait souvent au détriment de la technique », constate-t-il. Et au bout de presque vingt ans de métier, l’éleveur fait ce constat qu’une exploitation, « ça se pilote un peu comme une voiture : l’accélérateur, c’est la technique. Et le frein, c’est la maîtrise des charges. Or à l’heure où l’agriculture opère un virage, mieux vaut avoir de bons freins ! », observe-t-il.
Reproducteurs et bêtes grasse AOP
Chez les Mateuil, cette conviction « qu’il ne faut pas seulement faire naître, mais aussi valoriser derrière » n’est pas nouvelle. Le père de Guillaume pensait déjà ainsi lorsqu’il engraissait tous ses mâles en bœufs qu’il livrait alors gras à la Sicasel. Mais à partir de 1999, l’élevage inscrit s’est mis à vendre quelques reproducteurs. Aujourd’hui, via à son site internet, Guillaume parvient à valoriser pratiquement tous ses mâles en reproducteurs, pour moitié à l’âge de 6 à 10 mois et le reste à 18-24 mois. Les animaux sont livrés dans toute la France. Au final, Guillaume ne vend jamais de broutard.
Côté femelles, outre les futures reproductrices, 17 ou 18 génisses sont engraissées. Une dizaine sont valorisées en AOP Bœuf de Charolles, ce qui leur garantit une plus-value pouvant grimper jusqu’à +80 centimes d’€, confie l’éleveur. Les autres femelles grasses partent dans la filière "Cœur de gamme" avec une plus value de +0,8 centime du kilo, complète Guillaume.
Or vert
Fier de la démarche AOP, l’éleveur d’Oudry a toujours cru au lien entre le terroir et la qualité de viande et cela dans un secteur réputé pour la qualité de ses herbages. Guillaume estime en effet que l’herbe constitue « un véritable or vert ». Son père pratiquait déjà le pâturage tournant depuis les années 80. « C’est l’exploitation de l’herbe et le pâturage tournant qui nous permettent d’être autonomes au niveau alimentaire. Les veaux réalisent de très bonnes croissances et on peut même engraisser des animaux à l’herbe », confie l’éleveur. Ce dernier n’hésite pas à lâcher ses femelles dès le 1er mars. « C’est souvent un très beau mois et les animaux valorisent le peu d’herbe qu’il y a avec du foin à côté pour une bonne transition. Les jeunes bêtes ne sont pas complémentées en hiver. Leur croissance est très faible en bâtiment. Mais dès que je les lâche au mois de mars, elles réalisent une croissance compensatrice, ce qui me permet de travailler à moindre coût », explique Guillaume. En récoltant une herbe de qualité, l’éleveur parvient à se passer de concentré en hiver. Un peu d’orge suffit à couvrir les besoins des animaux. Les bêtes à l’engraissement sont généralement finies à l’herbe du printemps à l’automne. Elles reçoivent un peu de lin, conformément au cahier des charges de l’AOP.
Vêlages tardifs
Comme les anciens le faisaient en leur temps, Guillaume entend adapter son système au cycle de l’herbe. En participant à la formation « comment dégager du revenu » dispensée par la Chambre d’agriculture, l’éleveur s’était rendu compte que ses frais d’élevage étaient importants du fait de vêlages précoces de novembre-décembre. « Le système qui valorise le mieux l’herbe, c’est celui qui repose sur des vêlages tardifs avec un deuxième passage à l’herbe pour les jeunes animaux », rapporte Guillaume. Du coup, il a décidé de retarder ses dates de vêlage d’environ six semaines. Les mises bas se dérouleront désormais entre le 15 janvier et le 15 avril. Cela permet aussi de lâcher les vaches suitées plus tôt. Car dans le cas de vêlages précoces, la reproduction en février-mars retarde la mise à l’herbe ce qui pénalise toute la récolte, explique l’éleveur.
Avec des vaches rentrées au 1er décembre, l’éleveur dispose désormais de six semaines pour préparer ses femelles au vêlage dans de bonnes conditions (alimentation, minéraux, déparasitage, vaccination…). Un gage pour obtenir un bon colostrum, fait-il valoir. Avec cette nouvelle organisation, Guillaume s’attend à un pic de travail début mars, mais ce sera le moment du premier lâcher d’animaux. Les conditions sanitaires seront meilleures. Et la vie de famille aura été préservée pour les fêtes de fin d’années, fait-il remarquer.
Pour Guillaume Mateuil, « le métier a encore de l’avenir ! »

Guillaume Mateuil s’est installé en 1999 sur la ferme familiale d’Oudry. Une installation atypique car le jeune éleveur ne voulait pas agrandir la structure de ses parents. En rejoignant son père dans un Gaec, son projet était de conserver la structure existante. Aller chercher de la valeur ajoutée plutôt que développer la production, explique-t-il. Et c’est en convertissant l’élevage dans l’agriculture biologique que Guillaume projetait de gagner une plus value de +0,30 à 0,46 € par kilo de viande produit. De quoi supporter son installation avait-il calculé.
Ce choix audacieux « revenait à refuser la transparence économique et l’ajout d’une SMI ainsi que faire l’impasse sur les primes supplémentaires », explique-t-il. Refusé en CDOA, son dossier a alors dû être défendu au ministère avec le soutien du syndicalisme. « Cela s’est pourtant avéré viable », révèle aujourd’hui Guillaume.
En 2006, année du départ en retraite de ses parents, le jeune éleveur a pu reprendre l’ensemble du capital de la ferme qui était moins important que si elle avait été agrandie.
Depuis 1999, l’exploitation de la famille Mateuil a toujours possédé un cheptel charolais de 70 à 75 vêlages. La surface s’est légèrement restructurée passant de 114 à 123 hectares. Pour Guillaume, « pour bien faire son travail, il faut se limiter. L’agrandissement se fait souvent au détriment de la technique », constate-t-il. Et au bout de presque vingt ans de métier, l’éleveur fait ce constat qu’une exploitation, « ça se pilote un peu comme une voiture : l’accélérateur, c’est la technique. Et le frein, c’est la maîtrise des charges. Or à l’heure où l’agriculture opère un virage, mieux vaut avoir de bons freins ! », observe-t-il.
Reproducteurs et bêtes grasse AOP
Chez les Mateuil, cette conviction « qu’il ne faut pas seulement faire naître, mais aussi valoriser derrière » n’est pas nouvelle. Le père de Guillaume pensait déjà ainsi lorsqu’il engraissait tous ses mâles en bœufs qu’il livrait alors gras à la Sicasel. Mais à partir de 1999, l’élevage inscrit s’est mis à vendre quelques reproducteurs. Aujourd’hui, via à son site internet, Guillaume parvient à valoriser pratiquement tous ses mâles en reproducteurs, pour moitié à l’âge de 6 à 10 mois et le reste à 18-24 mois. Les animaux sont livrés dans toute la France. Au final, Guillaume ne vend jamais de broutard.
Côté femelles, outre les futures reproductrices, 17 ou 18 génisses sont engraissées. Une dizaine sont valorisées en AOP Bœuf de Charolles, ce qui leur garantit une plus-value pouvant grimper jusqu’à +80 centimes d’€, confie l’éleveur. Les autres femelles grasses partent dans la filière "Cœur de gamme" avec une plus value de +0,8 centime du kilo, complète Guillaume.
Or vert
Fier de la démarche AOP, l’éleveur d’Oudry a toujours cru au lien entre le terroir et la qualité de viande et cela dans un secteur réputé pour la qualité de ses herbages. Guillaume estime en effet que l’herbe constitue « un véritable or vert ». Son père pratiquait déjà le pâturage tournant depuis les années 80. « C’est l’exploitation de l’herbe et le pâturage tournant qui nous permettent d’être autonomes au niveau alimentaire. Les veaux réalisent de très bonnes croissances et on peut même engraisser des animaux à l’herbe », confie l’éleveur. Ce dernier n’hésite pas à lâcher ses femelles dès le 1er mars. « C’est souvent un très beau mois et les animaux valorisent le peu d’herbe qu’il y a avec du foin à côté pour une bonne transition. Les jeunes bêtes ne sont pas complémentées en hiver. Leur croissance est très faible en bâtiment. Mais dès que je les lâche au mois de mars, elles réalisent une croissance compensatrice, ce qui me permet de travailler à moindre coût », explique Guillaume. En récoltant une herbe de qualité, l’éleveur parvient à se passer de concentré en hiver. Un peu d’orge suffit à couvrir les besoins des animaux. Les bêtes à l’engraissement sont généralement finies à l’herbe du printemps à l’automne. Elles reçoivent un peu de lin, conformément au cahier des charges de l’AOP.
Vêlages tardifs
Comme les anciens le faisaient en leur temps, Guillaume entend adapter son système au cycle de l’herbe. En participant à la formation « comment dégager du revenu » dispensée par la Chambre d’agriculture, l’éleveur s’était rendu compte que ses frais d’élevage étaient importants du fait de vêlages précoces de novembre-décembre. « Le système qui valorise le mieux l’herbe, c’est celui qui repose sur des vêlages tardifs avec un deuxième passage à l’herbe pour les jeunes animaux », rapporte Guillaume. Du coup, il a décidé de retarder ses dates de vêlage d’environ six semaines. Les mises bas se dérouleront désormais entre le 15 janvier et le 15 avril. Cela permet aussi de lâcher les vaches suitées plus tôt. Car dans le cas de vêlages précoces, la reproduction en février-mars retarde la mise à l’herbe ce qui pénalise toute la récolte, explique l’éleveur.
Avec des vaches rentrées au 1er décembre, l’éleveur dispose désormais de six semaines pour préparer ses femelles au vêlage dans de bonnes conditions (alimentation, minéraux, déparasitage, vaccination…). Un gage pour obtenir un bon colostrum, fait-il valoir. Avec cette nouvelle organisation, Guillaume s’attend à un pic de travail début mars, mais ce sera le moment du premier lâcher d’animaux. Les conditions sanitaires seront meilleures. Et la vie de famille aura été préservée pour les fêtes de fin d’années, fait-il remarquer.
Pour Guillaume Mateuil, « le métier a encore de l’avenir ! »

Guillaume Mateuil s’est installé en 1999 sur la ferme familiale d’Oudry. Une installation atypique car le jeune éleveur ne voulait pas agrandir la structure de ses parents. En rejoignant son père dans un Gaec, son projet était de conserver la structure existante. Aller chercher de la valeur ajoutée plutôt que développer la production, explique-t-il. Et c’est en convertissant l’élevage dans l’agriculture biologique que Guillaume projetait de gagner une plus value de +0,30 à 0,46 € par kilo de viande produit. De quoi supporter son installation avait-il calculé.
Ce choix audacieux « revenait à refuser la transparence économique et l’ajout d’une SMI ainsi que faire l’impasse sur les primes supplémentaires », explique-t-il. Refusé en CDOA, son dossier a alors dû être défendu au ministère avec le soutien du syndicalisme. « Cela s’est pourtant avéré viable », révèle aujourd’hui Guillaume.
En 2006, année du départ en retraite de ses parents, le jeune éleveur a pu reprendre l’ensemble du capital de la ferme qui était moins important que si elle avait été agrandie.
Depuis 1999, l’exploitation de la famille Mateuil a toujours possédé un cheptel charolais de 70 à 75 vêlages. La surface s’est légèrement restructurée passant de 114 à 123 hectares. Pour Guillaume, « pour bien faire son travail, il faut se limiter. L’agrandissement se fait souvent au détriment de la technique », constate-t-il. Et au bout de presque vingt ans de métier, l’éleveur fait ce constat qu’une exploitation, « ça se pilote un peu comme une voiture : l’accélérateur, c’est la technique. Et le frein, c’est la maîtrise des charges. Or à l’heure où l’agriculture opère un virage, mieux vaut avoir de bons freins ! », observe-t-il.
Reproducteurs et bêtes grasse AOP
Chez les Mateuil, cette conviction « qu’il ne faut pas seulement faire naître, mais aussi valoriser derrière » n’est pas nouvelle. Le père de Guillaume pensait déjà ainsi lorsqu’il engraissait tous ses mâles en bœufs qu’il livrait alors gras à la Sicasel. Mais à partir de 1999, l’élevage inscrit s’est mis à vendre quelques reproducteurs. Aujourd’hui, via à son site internet, Guillaume parvient à valoriser pratiquement tous ses mâles en reproducteurs, pour moitié à l’âge de 6 à 10 mois et le reste à 18-24 mois. Les animaux sont livrés dans toute la France. Au final, Guillaume ne vend jamais de broutard.
Côté femelles, outre les futures reproductrices, 17 ou 18 génisses sont engraissées. Une dizaine sont valorisées en AOP Bœuf de Charolles, ce qui leur garantit une plus-value pouvant grimper jusqu’à +80 centimes d’€, confie l’éleveur. Les autres femelles grasses partent dans la filière "Cœur de gamme" avec une plus value de +0,8 centime du kilo, complète Guillaume.
Or vert
Fier de la démarche AOP, l’éleveur d’Oudry a toujours cru au lien entre le terroir et la qualité de viande et cela dans un secteur réputé pour la qualité de ses herbages. Guillaume estime en effet que l’herbe constitue « un véritable or vert ». Son père pratiquait déjà le pâturage tournant depuis les années 80. « C’est l’exploitation de l’herbe et le pâturage tournant qui nous permettent d’être autonomes au niveau alimentaire. Les veaux réalisent de très bonnes croissances et on peut même engraisser des animaux à l’herbe », confie l’éleveur. Ce dernier n’hésite pas à lâcher ses femelles dès le 1er mars. « C’est souvent un très beau mois et les animaux valorisent le peu d’herbe qu’il y a avec du foin à côté pour une bonne transition. Les jeunes bêtes ne sont pas complémentées en hiver. Leur croissance est très faible en bâtiment. Mais dès que je les lâche au mois de mars, elles réalisent une croissance compensatrice, ce qui me permet de travailler à moindre coût », explique Guillaume. En récoltant une herbe de qualité, l’éleveur parvient à se passer de concentré en hiver. Un peu d’orge suffit à couvrir les besoins des animaux. Les bêtes à l’engraissement sont généralement finies à l’herbe du printemps à l’automne. Elles reçoivent un peu de lin, conformément au cahier des charges de l’AOP.
Vêlages tardifs
Comme les anciens le faisaient en leur temps, Guillaume entend adapter son système au cycle de l’herbe. En participant à la formation « comment dégager du revenu » dispensée par la Chambre d’agriculture, l’éleveur s’était rendu compte que ses frais d’élevage étaient importants du fait de vêlages précoces de novembre-décembre. « Le système qui valorise le mieux l’herbe, c’est celui qui repose sur des vêlages tardifs avec un deuxième passage à l’herbe pour les jeunes animaux », rapporte Guillaume. Du coup, il a décidé de retarder ses dates de vêlage d’environ six semaines. Les mises bas se dérouleront désormais entre le 15 janvier et le 15 avril. Cela permet aussi de lâcher les vaches suitées plus tôt. Car dans le cas de vêlages précoces, la reproduction en février-mars retarde la mise à l’herbe ce qui pénalise toute la récolte, explique l’éleveur.
Avec des vaches rentrées au 1er décembre, l’éleveur dispose désormais de six semaines pour préparer ses femelles au vêlage dans de bonnes conditions (alimentation, minéraux, déparasitage, vaccination…). Un gage pour obtenir un bon colostrum, fait-il valoir. Avec cette nouvelle organisation, Guillaume s’attend à un pic de travail début mars, mais ce sera le moment du premier lâcher d’animaux. Les conditions sanitaires seront meilleures. Et la vie de famille aura été préservée pour les fêtes de fin d’années, fait-il remarquer.




